P. Joseph Famerée SCJ: Mutations culturelles et ecclésialité en Europe
Père Joseph Famerée, scj Ciney 21/4/2009
Faculté de théologie
Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Pour la liste des publications veuillez cliquer
**************************************************************************************
Mutations culturelles et ecclésialité en Europe
I. Situation culturelle du monde occidental
1. Qu’est-ce que la modernité culturelle ou la culture moderne ?
11. L’avènement de la subjectivité individuelle
12. L’émergence des sciences et des techniques, source profonde de la « sécularisation »
13. Émancipation du politique par rapport au religieux ou le sens historiquement premier du mot « sécularisation »
14. La privatisation du religieux ou la généralisation de la « sécularisation »
2. Évolutions récentes des sociétés modernes : le super-marché des religions, une rationalité moins sûre d’elle-même
21. « Retour » du religieux ?
22. Une raison moins sûre d’elle-même
3. Mondialisation, internet, rencontre des cultures et des religions
II. Situation de l’Église dans les sociétés modernes
1. Culturellement
2. Numériquement et institutionnellement
3. Symboliquement
III. La mission de l’Église dans le monde
1. La mission de Jésus
11. L’Incarnation
12. La vie de Jésus de Nazareth
2. La mission de l’Église
21. À la suite de Jésus…
22. … dans les sociétés pluralistes occidentales
Je vous propose une analyse de la situation de l’Église (catholique romaine plus particulièrement) dans le monde contemporain. Je me centrerai sur le monde occidental (l’Europe notamment), même s’il est vrai qu’aujourd’hui toutes les parties du monde sont peu ou prou des vases communicants.
Je commencerai par une analyse culturelle globale du monde occidental actuel et du statut de la religion ou du religieux dans cette culture avant d’y examiner la place de l’Église et les implications de cette situation culturelle pour la vie ou la mission ecclésiale.
I. Situation culturelle du monde occidental
Depuis près de 20 ans, “postmodernité” est le mot à la mode pour caractériser notre culture actuelle. Je veux bien l’admettre, s’il désigne simplement une figure nouvelle de la modernité, mais pas s’il prétend indiquer une culture radicalement nouvelle qui supplanterait la modernité. Je pense en effet que nous sommes encore en pleine modernité culturelle, même si celle-ci connaît des évolutions et des recompositions importantes. À vous de juger, à partir de mon analyse, si cette affirmation est pertinente.
Dans un premier temps, je m’interrogerai sur les origines et les caractéristiques principales de la culture moderne; dans un deuxième et un troisième temps, je considérerai les évolutions récentes de cette culture: il s’agira, d’une part, de ce que l’on a appelé le “retour” du religieux et, d’autre part, du pluralisme religieux dans le contexte de la “mondialisation”.
1. Qu’est-ce que la modernité culturelle ou la culture moderne?
Pour comprendre le fond de notre culture, je pense qu’il faut remonter à la Renaissance (1400-1559).
11. L’avènement de la subjectivité individuelle
La Renaissance, avec son “anthropocentrisme”, fait émerger un type d’homme nouveau: cet homme aspire à une nouvelle éthique et à un exercice autonome de l’intelligence. À partir de la fin du 15e s., des ressources prodigieuses vont fonder les Temps modernes: découvertes scientifiques et techniques (pensons à Léonard de Vinci [1452-1519]), culture humaniste (Érasme [1469-1536]), explorations (entre autres, découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492), nouvelles philosophies politiques (Machiavel [1469-1527])… Ce bouillonnement intellectuel, en même temps qu’il révolutionne la vision du monde et de l’homme, appelle des révisions déchirantes dans le domaine de la pensée religieuse. C’est dans ce contexte de mutation profonde qu’il faut situer la Réforme protestante, une réforme du christianisme particulièrement adaptée à l’individualisme moderne en train de naître et à la désagrégation d’une société (“chrétienté”) féodale compacte et centrée sur elle-même, européocentrique également.
L’ère qui s’achève était dominée, en Occident, par l’Église à travers un pouvoir pontifical omniprésent et centralisé; celle qui s’ouvre est d’emblée placée sous le signe de l’émancipation du “profane” par rapport au sacré ou au religieux. Ce que l’on appellera plus tard “sécularisation” commence ici et peut être décrit comme un vaste processus d’ “autonomisation” des valeurs humaines et des réalités terrestres ou séculières par rapport à la tutelle de l’Église (en Occident au moment de la Renaissance). Par réalités séculières, j’entends la culture, la science, la politique, l’économie, la vie sociale, la morale et même le choix d’une religion… L’humaniste (l’homme de raison: homme de science, philosophe…) prend la place du clerc (de l’homme d’Église); un idéal terrestre (“mondain”) se substitue à l’idéal ascétique de la fuga mundi. C’est le début de l’anthropocentrisme, si caractéristique de la modernité, et la découverte de la subjectivité individuelle: sur le plan spirituel pensons à l’individualisation et à l’intériorisation de la foi dans la Devotio moderna déjà, dont L’Imitation de Jésus-Christ, au 15e s., est l’exemple-type; pensons à la “protestation” de Luther (1483-1546) au nom de sa foi intérieure et de sa lecture personnelle de l’Écriture contre des autorités extérieures et objectives; sur le plan intellectuel, pensons au doute méthodique de Descartes (1596-1650) et à son Cogito, ergo sum. Toutefois, cette Renaissance n’est pas typiquement anti-religieuse ou anti-chrétienne: songeons aux nombreux humanistes “chrétiens” du 16e s., Érasme (1469-1536) notamment. Le phénomène deviendra plus tard anti-chrétien, voire anti-religieux, en partie à cause de l’intolérance ecclésiale.
Cette “autonomisation” du sujet pensant (et de toutes les activités qui lui sont liées) trouve sa pleine réalisation dans le 18e s., le Siècle des Lumières (l’Aufklärung), avec un rayonnement social et culturel immense: Voltaire, Diderot, Kant (Aude sapere, raison critique)… La mise en œuvre de cette “autonomie” et de cette “rationalité” est alors entreprise par les Occidentaux avec passion et grâce aux moyens toujours plus perfectionnés de la science et de la technique. Ce mouvement, depuis la première moitié du 20e s., est porté par une large opinion publique, chrétienne aussi… même si, entre-temps, d’autres phénomènes culturels sont apparus. Nous touchons ici le paramètre le plus fondamental et le plus durable de la culture moderne : la promotion de l’individu, du sujet, qui, depuis quelques décennies, a tendance à se transformer en individualisme et en subjectivisme. C’est, je pense, le principal défi pour l’Église en Occident : comment refaire du lien entre des individus séparés et isolés ? Comment refaire de la socialité ? Ce n’est pas le croire qui pose problème aujourd’hui, c’est le croire ensemble (avec et comme d’autres), c’est le croire en Église.
12. L’émergence des sciences et des techniques, source profonde de la “sécularisation”
Qui dit émergence des sciences et des techniques dit élaboration de savoirs réglés et mise en place de procédés d’expérimentation de plus en plus rigoureuse adaptée à la spécificité de chaque domaine du réel (observation, hypothèse, vérification par l’expérience). La conception d’un réel différencié, pluriforme, obéissant à des règles spécifiques selon les angles d’approche (mathématique, physique, chimie, médecine, économie, droit…) s’impose ainsi peu à peu aux esprits. Tel est le sens le plus profond de la sécularisation: une différenciation ou une “autonomisation” toujours plus fine des différents domaines du réel les uns par rapport aux autres.
Une telle conception ne peut que saper l’idée selon laquelle existerait un point de vue unique (total, absolu), capable d’embrasser d’un seul regard la diversité des choses dans leurs relations. Du coup, se trouve dévaluée l’idée d’une science des sciences: la théologie (telle qu’on la comprenait à l’âge scolastique) se voit ainsi radicalement relativisée dans sa prétention à ordonner la totalité des savoirs. L’Esprit Saint, disait Galilée (1564-1642), explique comment on va au ciel, mais non pas comment va le ciel. Tel est à l’état pur le schéma de la sécularisation. Cette différence entre les sciences naturelles et la théologie (la foi), voilà précisément ce que peu d’hommes d’Église purent comprendre à l’époque. Cette incompréhension entre Galilée et ses juges ecclésiastiques est grosse de tous les malentendus postérieurs entre science (raison) et foi, entre science et Bible, entre science historique et dogmes, entre Jésus historique et Christ de la foi… à l’époque du “modernisme”. Cette question ne me paraît pas encore résolue au sein du christianisme. En ce bicentenaire de la naissance de Darwin (1809), on est pour le moins interloqué de découvrir que l’évolutionnisme est à nouveau combattu par des chrétiens fondamentalistes (évangéliques), comme d’ailleurs par des musulmans, au profit du fixisme ou du créationnisme tiré de la lettre de la Bible ou du Coran.
La conséquence de cette différenciation du réel due aux sciences n’est pas nécessairement un relativisme généralisé; ce peut être une saine relativisation des différentes approches humaines du réel: aucune, fût-ce la religion, ne peut prétendre à un point de vue absolu et total, encore moins au seul valable, sur la réalité. En même temps, l’homme prend de plus en plus conscience de tout ce qu’il peut réaliser par lui-même, par les ressources de sa raison et de ses inventions.
13. Émancipation du politique par rapport au religieux ou le sens historiquement premier du mot “sécularisation”
L’émancipation progressive et difficile des réalités séculières, y compris de la morale (avec l’autonomie kantienne de la raison pratique), aboutira, sur le plan politique, à un conflit retentissant entre Église et État au cours du 19e s. (suite à la Révolution française et à l’abolition de l’Ancien régime de la Monarchie absolue de droit divin).
La “sécularisation” au sens premier du mot renvoie d’abord à un phénomène juridique et politique: celui de la séparation des Églises et de l’État. La France est ici à l’avant-garde. Jusqu’à la Révolution française, il y eut une alliance objective (sinon toujours subjective) entre État (Monarchie de droit divin, garantie par la religion chrétienne) et Église. Suite au séisme révolutionnaire, une séparation entre Église et État, plus ou moins radicale et plus ou moins violente selon les pays, ainsi qu’une “sécularisation” (laïcisation) des biens ecclésiastiques, va s’instaurer un peu partout en Europe (avec pour conséquence notamment la liberté des cultes). Dans certaines nations, il faut attendre pour cela la seconde moitié du 20e s.: pensons à l’État confessionnel (catholique) espagnol. La Grèce contemporaine ne connaît pas encore de véritable séparation entre l’État et l’Église orthodoxe (même si la liberté religieuse est reconnue dans la Constitution, il faut être orthodoxe pour être un vrai Grec).
Même là où la liberté religieuse est aujourd’hui pleinement reconnue et pratiquée, que de différences nationales entre la Grande-Bretagne (où le chef de l’État, la reine, est en même temps Supreme Governor de l’Église anglicane), les États-Unis (où une forte religiosité – protestante – imprègne la vie sociale, malgré la stricte séparation inscrite dans la Constitution) et la France (où une radicale séparation entre l’État républicain et les Églises ne va pas sans de multiples accommodements pratiques), entre le reste de la France et l’Alsace-Lorraine, avec son régime concordataire et la rétribution des curés par l’État, entre la France et la Belgique (où une forte communauté catholique, malgré la neutralité de l’État, a pu faire valoir ses droits et obtenir la reconnaissance légale ainsi que le subventionnement par l’État de ses écoles, de ses hôpitaux et de nombreuses autres institutions catholiques), entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg aussi quant au traitement du clergé…
Ceci met en évidence qu’il n’y a pas “une seule” société moderne (occidentale ou même européenne), car celle-ci n’émerge que dans des traditions culturelles et nationales différentes. Il reste cependant, et telle est la vérité de cette signification première de la “sécularisation”, qu’un État moderne ne tolère pas la domination de l’instance religieuse, mais prétend ou bien régler lui-même juridiquement ses rapports avec elle, ou bien la tenir en tutelle, ou encore l’ignorer au nom de sa neutralité face à la pluralité des croyances. Cette situation n’est pas générale dans le monde. La comparaison de notre situation avec celle des pays islamiques (l’Afghanistan, l’Iran khomeiniste, mais aussi l’Arabie Saoudite et même les pays du Maghreb…) fait ressortir l’originalité de notre tradition et suggère qu’une telle séparation (ou en tout cas distinction) de l’État et de la religion dans l’Occident “chrétien” a sans doute quelque chose à voir avec le christianisme.
14. La privatisation du religieux ou la généralisation de la “sécularisation”
Au-delà d’une séparation juridique (imposée parfois violemment et jamais acceptée de bon cœur par l’Église catholique, même encore aujourd’hui), culturellement, le religieux s’est effacé de plus en plus de l’espace public pour être relégué dans les marges de la société et le domaine du privé. Ce phénomène était en germe depuis longtemps, mais c’est depuis les années 60-70 qu’il s’est imposé comme une réalité sociologique largement partagée: en sont des signes la diminution radicale du christianisme “sociologique” (on est chrétien parce que tout le monde l’est), la disparition consécutive de l’obligation “sociologique” dominicale (on va à la messe comme tout le monde) et la baisse considérable de la pratique religieuse, la disparition des “processions” religieuses et des “rogations”, même si çà et là il y a des tentatives de résurrection de ces “processions” (dans une perspective parfois plus folklorique que religieuse d’ailleurs)…
La politique, la vie sociale, l’économie n’ont pas besoin de la religion pour bien fonctionner; il n’est même pas nécessaire d’être “croyant” pour être moral… Et si l’Église, par la bouche des évêques, exprime publiquement sa position sur tel ou tel sujet de société (l’avortement, par ex.), beaucoup d’hommes politiques auront tendance à dire: “Mais de quoi se mêle-t-elle?”; l’Église pourra même être soupçonnée de vouloir imposer sa morale à l’ensemble de la société. La religion est bel et bien perçue aujourd’hui en Occident comme une affaire privée, qui n’a pas à interférer dans le champ public. Les guerres de religion du 16e s. ont discrédité le christianisme historique et institutionnel (ou plus généralement la religion) comme source de paix publique (on peut penser aussi à des exemples plus récents en Irlande, en ex-Yougoslavie… même si des facteurs non religieux jouent), aussi revient-il à un État laïc (neutre) de pacifier l’espace public; la religion pourra certes subsister, mais dans la marge, à condition, toutefois, de ne pas perturber le droit et la paix garantis par l’État moderne.
Si l’État est neutre et garantit la liberté de culte ou d’opinion, la société (civile), elle, est pluraliste: plusieurs religions, plusieurs opinions philosophiques… s’y côtoient. Tel est le propre des démocraties modernes: rien ne peut y être décidé sans un débat entre leurs multiples composantes en vue d’atteindre un consensus (au moins majoritaire). Dans un tel contexte, il serait non pertinent et inacceptable culturellement qu’une Église ou une religion prétende dire “l’unique” vérité sur la vie en société (voyez comment les paroles d’un pape peuvent être reçues !). Les décisions relatives à la vie en société ne peuvent être que le résultat d’un débat et d’un consensus plus ou moins large entre les acteurs de celle-ci.
2. Évolutions récentes des sociétés modernes: le super-marché des religions,
une rationalité moins sûre d’elle-même
Beaucoup de sociologues des années 60-70 pensaient que le processus de la sécularisation conduirait à la disparition pure et simple du religieux dans les sociétés modernes. Or le religieux n’a pas disparu de ces sociétés, même s’il a été, pour une grande part, exilé de l’espace public. Il est même resté bien vivant, certes sous une forme plus individualisée et privatisée. Depuis une trentaine d’années, on a même beaucoup parlé d’un “retour” du religieux.
21. “Retour” du religieux?
L’expression vient sans doute de sociologues qui avaient cru au “départ” ou à l’exclusion du religieux hors du monde moderne. Il vaudrait sans doute mieux parler d’ “arrivée” de nouvelles formes de religiosité. En effet, par “retour” du religieux, on ne désigne pas tant la « revigoration » des grandes religions institutionnelles (même si ici aussi il y a des réaffirmations identitaires) que la prolifération de nouvelles (ou anciennes) religiosités: culte astral, New Age (sacralité cosmique), “para-sciences” (astrologie, parapsychologie, radiesthésie…), groupes sectaires (Église de scientologie, par ex.)… Le religieux s’est modifié, il s’est « dérégulé » et « désinstitutionnalisé » (D. Hervieu-Léger).
S’agit-il pour autant de phénomènes opposés à la sécularisation? Pas nécessairement. Ce sont peut-être même pour une part des produits déguisés de la sécularisation elle-même. Ces “religiosités”, en effet, ne refusent pas la rationalité scientifique moderne, elles s’efforcent au contraire d’en mimer la rigueur méthodologique (l’astrologie, par ex.). En outre, le recours à ces parasciences traduit un besoin d’unification affective et existentielle pour des individus qui perdent leurs bases, leurs repères idéologiques et leur encadrement social (isolement affectif, absence de travail, vie urbaine plus que rurale…); plutôt que d’un “retour”, il s’agit donc sans doute d’un “début” de phénomènes liés aux sociétés modernes de l’individualisme. Par ailleurs, cette efflorescence de sacralités et de religiosités sauvages, floues, touche seulement une infime minorité de la population occidentale (même si toutes les couches de celle-ci sont touchées, les couches supérieures surtout peut-être). Une grande partie du monde occidental reste plutôt indifférente à la religion, sans lui être hostile pour autant: à l’occasion, on se pose des questions religieuses, on recourt même à certains services de la religion (« les chrétiens à quatre roues » : baptême, communion, mariage, enterrement), mais on n’en vit pas quotidiennement; on n’a pas besoin de religion pour vivre moralement et connaître le bonheur familial et relationnel. Le schéma foncier de la sécularisation (autonomie du profane par rapport au religieux) ne me semble donc pas remis en question par l’apparition de ces nouvelles formes de religiosité.
22. Une raison moins sûre d’elle-même
Parallèlement à la généralisation de la culture sécularisée et à l’efflorescence de nouvelles religiosités (qui est sans doute aussi le symptôme d’une résistance à un certain désenchantement d’un monde désormais sans mystères et sans surprises, où tout serait rationnellement planifié, qui est également le rappel, parfois perverti, d’autres dimensions humaines comme l’imagination, le corps, l’art, l’autre de la raison ou un certain “irrationnel” ou “non-rationnel”, le cosmos…), la rationalité scientifique est devenue plus humble. La science technicienne sait désormais qu’elle ne maîtrise pas tous les effets (pervers notamment) de ses découvertes et inventions. On sait aujourd’hui les effets de la pollution automobile et industrielle sur le réchauffement de la planète, qui est difficilement contrôlable dans ses conséquences; on connaît aujourd’hui les trous dans la couche d’ozone, dus à l’usage de certains gaz; on voit aussi les conséquences dramatiques des déforestations massives pour l’équilibre de la nature… On est en mesure aujourd’hui de faire des clones humains… Quelles en seront les conséquences pour les êtres humains?… Les savants aujourd’hui sont devenus modestes: ils savent qu’ils ignorent beaucoup plus qu’ils ne savent. Chez eux du moins, le scientisme est bien mort, cette idéologie si caractéristique de la modernité triomphante du 19e s. selon laquelle seule la rationalité scientifique peut dire quelque chose de vrai sur la réalité, selon laquelle aussi la science arrivera, inéluctablement, de progrès en progrès, à percer tous les secrets de la nature et à résoudre toutes les questions de l’homme. Bel optimisme un peu naïf, aujourd’hui fortement tempéré. Pour les savants, non seulement la science ne peut pas tout résoudre comme par enchantement (même si elle continue à progresser, mais avec des ratés et des incertitudes), mais la science ne peut se suffire à elle-même, elle provoque la conscience éthique de tous, et d’abord des scientifiques: pas de science sans conscience, pas de science sans éthique.
Plus globalement, le 20e s. a vu les méfaits et la chute de grandes idéologies réalisées: nazisme, fascisme, communisme (depuis 1989), grands mouvements collectifs et mobilisateurs, porteurs de projets de société… Il n’y a plus aujourd’hui de grands projets de société ou de grands systèmes de pensée mobilisateurs; y en aurait-il qu’ils ne seraient sans doute plus crédibles (on le voit déjà, depuis une quarantaine d’années, dans la crise du militantisme, signe d’une crise plus profonde de l’espérance à long terme: on ne s’engage plus facilement ni durablement dans des mouvements bien structurés et institutionnalisés). L’individualisme moderne s’étant généralisé grâce à l’élévation du niveau de vie et du niveau d’éducation, grâce à l’information et aux médias, l’homme du début de ce siècle est plutôt méfiant vis-à-vis des grandes explications totalisantes et préfère faire son shopping (zapping) intellectuel ou spirituel: un peu de sciences, un peu d’éthique stoïcienne à la Comte-Sponville, un peu de christianisme (peut-être même sécularisé à la manière de Luc Ferry), un peu de bouddhisme, un peu de yoga, un peu d’Islam… Les combinaisons sont subtiles et multiples: on pourrait parler de bricolages intellectuels et spirituels. Menu à la carte. D’où la difficulté de faire entrer l’individu moderne dans une tradition religieuse, parfois bimillénaire (avec sa cohérence, son caractère institué), dans une lignée de croyants. L’homme moderne est plutôt porté à l’éclectisme et au syncrétisme. Du point de vue de l’évangélisation, il est donc sans doute tout à fait illusoire, en Occident, d’aller encore à la « pêche au filet » : il faut aller à la « pêche à la ligne » pour atteindre et accompagner l’individu personnellement, de manière personnalisée.
Culturellement parlant, l’individu moderne manque de critères pour orienter son existence: non pas qu’il n’y ait plus de critères ou qu’il n’y en ait pas assez, il y en a trop en quelque sorte, trop qui soient trop peu repérables dans la foire aux idées philosophiques et religieuses de nos sociétés pluralistes et démocratiques. Comment s’y retrouver? Comment choisir? L’individu moderne est libre, mais solitaire devant cette lourde responsabilité. Dans les sociétés modernes, il n’y a plus un sens, communément partagé, de l’existence humaine. Le sens est désormais morcelé, émietté et désarticulé (le grand défi est de faire une synthèse personnelle qui se tienne; culturellement ou socialement parlant, il n’y a plus de grandes synthèses qui donnent une certaine vision du monde unifiée, de son origine et de sa fin, d’où, en réaction, les tentations identitaires, fondamentalistes et intégristes). On pourrait parler d’un subtil nihilisme. Non pas que rien n’ait plus de valeur, mais plus rien n’a de valeur absolue (l’homme d’aujourd’hui trouve sens à entreprendre, à chercher, à aimer…, mais ces différents sens valables ont tendance à être dévalués de l’intérieur et à se dégrader en utilitarisme, activisme, en aventures amoureuses passagères et successives… ; ce qui n’est pas favorisé par l’air du temps, c’est de retrouver sens, goût, désir à vouloir gratuitement ces valeurs pour elles-mêmes). Tout est marqué par une certaine fragilité, comme l’individu d’ailleurs, facilement narcissique et frileux vis-à-vis du monde ambiant (en dehors du cocon intimiste). Ainsi l’individu moderne a-t-il du mal à nouer des relations durables, dans le couple en particulier; les engagements longs (dans la vie religieuse ou le ministère ecclésial, par ex.) se voient dévalorisés dans une culture du changement permanent…
L’individualisme reste donc un paramètre culturel très vivace, entre autres dans le domaine religieux, avec un penchant au “subjectivisme” et au relativisme des valeurs: fragilisation intrinsèque, inconsistance native des valeurs modernes, éclatement ou absence de lien véritable entre elles. Vivre “cool”, tel est aujourd’hui le “mot d’ordre” culturel, si l’on peut dire: “dilettantisme” du sens et des valeurs. Ce qui ne signifie pas absence de recherche éthique. Au contraire. Dans le domaine de la pensée, la métaphysique et la philosophie en général (pour ne pas parler de la théologie) sont aujourd’hui remplacées par l’éthique. En effet, les questions concrètes posées par le monde moderne sont multiples et de plus en plus complexes (clonage, maïs transgénique, exclusion économique, insécurité, violence à l’école, pédophilie, parité homme-femme, sécurité alimentaire, effet de serre, transport de fuel), et simultanément le sujet moderne revendique sans cesse sa responsabilité personnelle devant ces questions en débat avec d’autres: il s’agit donc de trouver des repères, d’en débattre et de se mettre d’accord sur un minimum commun. On ne se préoccupe pas de grands principes éthiques, mais dans telle situation concrète, que dois-je faire, que devons-nous faire, comment allons-nous nous accorder et nous responsabiliser? Il y a là un véritable déplacement de la morale. Au temps du sida, être responsable, c’est respecter la vie de l’autre dans les relations sexuelles et donc il faut employer le préservatif; culturellement, la question de principe de la légitimité (morale) du préservatif ne se pose même pas. Aussi un certain discours de l’Église en la matière est-il culturellement inopérant ou inaudible, voire irrecevable. L’Église doit donc prendre toute la mesure de la nouvelle situation culturelle si elle veut y prononcer une parole audible et compréhensible.
3. Mondialisation, internet, rencontre des cultures et des religions
Concomitamment et accélérant d’ailleurs l’évolution culturelle, le phénomène social et économique de la mondialisation fait beaucoup parler de lui les dernières années, et encore tout récemment avec l’effondrement financier de la planète. On connaissait les entreprises multinationales, on pourrait parler aujourd’hui dans certains cas d’entreprises mondiales, exerçant un quasi-monopole dans le monde entier, comme la firme de Bill Gates dans le domaine de l’informatique. Les délocalisations d’entreprises de pays à haut salaire vers des pays à très bas salaire se multiplient, engendrant des pertes d’emploi dans les contrées industrialisées et des gains considérables pour les actionnaires de ces multinationales (même s’il y a eu de sérieuses baisses de gain les derniers mois). Le pouvoir économique se concentre de plus en plus dans les mains de quelques-uns et les États nationaux ont de moins en moins prise sur cette situation: le local est ainsi intégré dans un contexte toujours de plus en plus élargi. Le monde est devenu le “village global” de Mac Luhan; le monde est aussi devenu un supermarché, où tout peut être marchandé. On prend aussi mieux conscience de l’interdépendance de tous les peuples (riches et pauvres): même sur le simple plan de l’intérêt, les pays riches n’ont pas intérêt à exploiter et à piller les pays pauvres, car ils jouent ainsi leur propre survie et créent les conditions d’une immigration incontrôlable; sur le plan éthique, bien sûr, on mesure mieux les disparités intolérables entre les différentes parties du monde (par ex., comment pouvons-nous jouir ici d’une espèce de luxe médical, en pratiquant des opérations chirurgicales très coûteuses, alors que d’autres n’ont pas le minimum vital? Certains traitements très chers contre le sida peuvent être administrés en Occident, mais pas en Afrique, où la maladie prolifère pourtant).
Sur le plan de la communication, liée au développement prodigieux des techniques, il est désormais possible pour tout le monde (développé du moins) d’être interconnecté par le réseau informatique (internet, le web ou la toile informatique). Instantanément, on peut entrer en « contact » avec quelqu’un à l’autre bout du monde via le courrier électronique ou « skype ». On risque de devenir toujours plus pressé, plus impatient devant les lenteurs de son ordinateur, déjà très perfectionné pourtant; on a le souci de l’efficacité, mais on risque aussi de ne plus prendre le temps de laisser mûrir les questions (et certaines ont besoin de temps, même à l’heure d’internet). Grâce à l’informatique, on peut créer des “réalités” virtuelles (pensons aux jeux électroniques, aux films…), avec le risque de s’enfermer dans le virtuel et à la longue de ne plus distinguer suffisamment entre le virtuel et le réel (par ex., entre tuer quelqu’un virtuellement sur un vidéo-game et tuer une personne dans la réalité). Tout risque de devenir jeu, artificiel, virtuel.
Quelle société va s’engendrer ainsi? On peut aller dans le sens positif ou dans le sens négatif. Quelles régulations locales et mondiales inventer? Pensons à la finance « casino » et virtuelle. Pour les idées, les copies d’œuvres originales… Comment encore protéger aujourd’hui les droits d’auteurs? Tout peut être copié immédiatement (CD Rom, par ex.)… Quelle vérité est désormais possible? La société mondiale de l’information augmente le relativisme. La vérité est devenue plurielle: quelle consistance aura-t-elle encore? Les droits de l’homme vont-ils rester une référence indiscutée? Ou bien les États-Unis, grâce à leur puissance technique, vont-ils imposer leur loi et une seule vérité uniformisée?
Paradoxalement, au sein de ce monde globalisé, l’individu est seul et surfe en quête de repères, en quête d’identité, car il n’y a plus guère de normes universelles. Il essaie de constituer des réseaux, des bandes, des communautés d’amis dans un désert de solitudes individuelles. Si l’homme moderne est peu collectif, il se montre cependant très disponible pour les causes humanitaires, les groupes associatifs, les actions de proximité, le volontariat à durée déterminée (“Évangile” de l’humanitaire dans les médias), les grands rassemblements ponctuels (Taizé, JMJ…).
On rencontre cependant aussi des réactions identitaires plus dures à une modernité et à une mondialisation où les identités ont tendance précisément à se dissoudre: ce sont les régionalismes et nationalismes renaissants, ce sont aussi les intégrismes, les fondamentalismes philosophiques et religieux.
Parlant de religions, il faut aussi évoquer, mais dans un sens inverse, le pluralisme religieux qui est le nôtre aujourd’hui (il peut d’ailleurs aussi provoquer des réactions identitaires devant un certain métissage et relativisme religieux). Dans nos pays, depuis plusieurs décennies, à la faveur de l’immigration et des voyages, les religions les plus diverses ont appris à se côtoyer et à coexister plus ou moins pacifiquement. Chez nous, l’Islam a désormais sa place (tout à fait officielle et numériquement importante) à côté des religions plus traditionnelles (les différentes confessions chrétiennes, le judaïsme). Des occidentaux deviennent musulmans. Le bouddhisme est aussi implanté chez nous et séduit un certain nombre d’occidentaux en quête de paix et d’unification personnelle, paix et unification, liberté de cheminement spirituel qu’ils estiment ne pas trouver dans le christianisme, par exemple. Il est donc capital d’offrir à nos contemporains la possibilité de faire une expérience authentique, libre et profonde de la foi chrétienne. Ce contexte nouveau favorise un certain relativisme religieux, mais aussi une tolérance, un dialogue entre cultures différentes, entre religions différentes. Le grand défi actuel de la théologie, outre les questions éthiques, réside sans doute dans le dialogue interreligieux: comment le christianisme, avec sa prétention à l’universalité, va-t-il se situer dans ce nouvel environnement multiculturel et plurireligieux sur ses propres terres traditionnellement chrétiennes?
Complexité grandissante du monde actuel et des questions éthiques qu’il pose, déstructuration et morcellement du sens (pluralisme philosophique et religieux), absence de repères clairs, individualisme prononcé, privatisation du religieux, tels sont quelques paramètres de la culture occidentale actuelle.
II. Situation de l’Église dans les sociétés modernes
Beaucoup a déjà été suggéré. Je pourrai donc me permettre d’être assez bref. Je n’envisage pas ici la situation interne de l’Église, mais seulement le rapport entre Église et monde moderne, même si les deux sont étroitement liés. En effet, les catholiques sont eux aussi pour une très grande part imprégnés de culture moderne. Je me poserai respectivement la question de la place de l’Église (et plus globalement du christianisme) dans la culture actuelle, de son importance quantitative et qualitative dans la société, enfin de la perception que beaucoup en ont dans ce monde moderne.
1. Culturellement
Je vise ici les valeurs chrétiennes qui pétrissent notre culture. Même si l’on qualifie notre culture de “postchrétienne”, en ce sens que le christianisme explicitement professé (en Église) n’est plus l’instance principale (et même unique) de régulation d’une culture essentiellement pluraliste et laïque. Cette culture, qui n’est plus explicitement chrétienne, le reste encore foncièrement à un niveau implicite. Pour une grande part, ce sont des valeurs chrétiennes laïcisées ou sécularisées qui pétrissent notre culture et notre vie sociale: liberté, égalité, fraternité, les droits de l’homme, certaines procédures démocratiques (même si, socialement ou politiquement parlant, elles ont souvent été conquises contre les Églises ou le christianisme en tant qu’institution, qui y voyaient une menace pour l’autorité religieuse, ces valeurs n’en sont pas moins essentiellement d’origine judéo-chrétienne); la sécularisation elle-même ou cette légitime autonomie des réalités terrestres par rapport à l’instance religieuse et des réalités terrestres les unes par rapport aux autres, ce qui va de pair avec l’autonomisation d’un sujet conscient et libre par rapport aux déterminismes biologiques, par rapport à des autorités purement extérieures et hétéronomes, religieuses ou civiles (cela s’enracine foncièrement dans le sens judéo-chrétien de la création comme séparation [différence, altérité] entre Dieu et sa création, ainsi qu’entre les créatures elles-mêmes)…
Aujourd’hui, en Occident, le christianisme n’est sans doute plus un agent explicite dominant des transformations culturelles, quoique beaucoup de chrétiens, ouvertement ou souterrainement, de par leur engagement dans le monde, contribuent activement aux évolutions de notre culture et de notre société démocratique. Le christianisme n’en reste pas moins constitutivement et implicitement présent à notre culture. En définitive, n’est-ce pas une évangélisation réussie et durable, si des valeurs chrétiennes ont tellement été intégrées qu’on ne sait même plus qu’elles sont chrétiennes? Certes, l’évangélisation, des personnes notamment, doit être reprise aujourd’hui, sous d’autres formes et dans un autre contexte.
2. Numériquement et institutionnellement
En Occident, une assez grande majorité sont encore frottés de christianisme. Mais les chrétiens pratiquants et engagés deviennent une petite minorité, la moyenne d’âge étant élevée. Même si de nouveaux mouvements et communautés attirent de jeunes chrétiens convaincus, qu’est-ce que cela représente quantitativement dans l’océan de la jeunesse occidentale? Le destin du christianisme dans nos régions s’annonce très minoritaire (ce qui n’est pas nécessairement un mal), mais au train où vont les choses, on peut même se demander, d’un point de vue sociologique, si le christianisme va pouvoir survivre dans certaines régions d’Occident?
Ce que je viens de dire des personnes vaut aussi, et plus encore sans doute, des institutions ecclésiales classiques de type social, caritatif et scolaire. Si des reconversions n’étaient pas opérées (où le lien à l’Église peut disparaître complètement), beaucoup ne pourraient plus être tenues (par des congrégations religieuses notamment). Il y a certes encore de nombreuses institutions ecclésiales en Occident, mais beaucoup (des maisons religieuses notamment, différents services diocésains…) vont disparaître dans les années à venir, faute de personnel. La présence visible ou institutionnelle massive du christianisme dans les sociétés contemporaines risque ainsi de s’atténuer considérablement (sans même parler du nombre d’églises comme lieux de culte effectifs).
Si l’on ne prend pas certaines mesures intelligentes et courageuses, la présence de l’Église au monde moderne va se marginaliser et devenir insignifiante. J’en viens ainsi à mon troisième point, le plus important.
3. Symboliquement
Le catholicisme officiel est perçu de plus en plus dans certains milieux (intellectuels notamment, même catholiques) comme quelque chose de folklorique, une survivance du passé: des cérémonies, un certain apparat, un discours décalé, voire archaïque, sur toute une série de sujets (morale de l’existence individuelle notamment : sexuelle et bioéthique)… Bref, pour ces milieux radicaux, peut-être très lucides, l’Église officielle (pape, évêques…) n’est plus porteuse de vie et de sens. Elle est devenue insignifiante et inintéressante pour le monde d’aujourd’hui. Elle perd sa crédibilité non seulement à cause de certaines de ses positions, mais aussi à cause de sa manière d’exercer l’autorité et de prendre les décisions: dans une culture démocratique, le refus du débat est inacceptable et frappe de non-pertinence toute décision jugée autoritaire.
Actuellement, l’institution “Église catholique” (dans ses aspects les plus apparents et les plus médiatiques) semble à certains archaïque, une espèce de vestige du passé pour ce qui est de sa présence au monde et de son fonctionnement interne, quand elle n’est pas tout simplement ridiculisée dans les médias. Ces critiques, en fait, ne lui reprochent pas d’annoncer l’Évangile, mais plutôt de ne pas l’annoncer assez et assez bien, en paroles et en actes. Ils lui reprochent de ne pas être suffisamment un signe (un sacrement) de l’amour de Dieu pour les hommes ou un signe de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain (selon Vatican II), d’apparaître plus prohibitive que miséricordieuse, de vouloir imposer plutôt que de proposer une voie à des consciences et à des libertés… Au fond, le monde moderne lui reproche, parfois confusément, de ne pas refléter suffisamment la liberté de l’Évangile (cf. Galates 5, 1 et 13).
Symboliquement ou sacramentellement, l’institution ecclésiale n’apparaît plus à certains (qui seront peut-être beaucoup demain) comme un signe positif, mais plutôt comme un contre-signe dans toute une série de circonstances ou même, ce qui est peut-être encore plus grave, comme un non-signe. Je ne parle pas de tout ce qui est vivant dans l’Église catholique et est bien accueilli dans le monde moderne, mais n’est pas nécessairement perçu comme représentant l’Église.
Nous avons donc tout un travail individuel et collectif à accomplir pour rendre la communauté ecclésiale à nouveau signifiante dans le monde moderne, par un témoignage humble et convaincu, verbal et existentiel, personnel et communautaire, rendu au Christ ressuscité. C’est ce que je voudrais un peu développer dans la section suivante.
III. La mission de l’Église dans le monde
Comment concevoir le rôle et la place de l’Église dans le monde d’aujourd’hui ? En fonction de ce qu’est l’Église et de ce qu’est le monde actuel. Je ne prétends donc pas formuler une proposition valable pour toutes les situations historiques et culturelles. Je me situe d’ailleurs plus spécifiquement dans le cadre de l’Europe occidentale. Sans prétendre fournir une réponse universelle, je voudrais cependant rappeler des repères fondamentaux, qui, eux, me semblent valables à toutes les époques de la vie de l’Église et particulièrement pertinents pour notre temps et notre contexte culturel européen.
Je vais formuler mes options théologiques et en donner les raisons. Ce sont des options parmi d’autres, mais ce sont en même temps les options qui me paraissent les plus conformes à la Parole de Dieu, telle qu’elle est consignée dans l’Écriture et interprétée (reçue) dans la Tradition de l’Église.
J’énonce d’emblée ma vision générale du rapport de l’Église, c.-à-d. de tout le peuple ecclésial, au monde, avant même de l’argumenter. L’Église, me semble-t-il, doit doublement se décentrer d’elle-même : par rapport au Christ, lui-même décentré de lui-même (dans l’Esprit) par rapport au Père et au Royaume de Dieu qui vient parmi les humains; par rapport au monde. En d’autres termes, l’Église n’est pas là pour elle-même, elle est là pour-le-Christ (de Dieu et son Royaume) et pour-le-monde, elle est là pour l’Autre et pour l’autre (les autres) [en tout cas pas pour elle-même]. Elle ne doit donc pas tant se soucier d’une présence quantitativement [numériquement, socialement, économiquement] forte dans le monde que d’une présence qualitativement pertinente et interpellante. Elle ne doit pas tant se soucier de son expansion quantitative, voire même seulement de sa survie institutionnelle, que de son service désintéressé de Dieu (du Royaume) et du monde (de la vie et de la joie du monde), un véritable service sans arrière-pensée de conquête missionnaire. « Qui veut sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » (Mc 8, 35) « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils , son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » (Jn 3, 16-17) « Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre ; moi, je suis venu pour qu’ils [les hommes] aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » (Jn 10, 10) Je plaide donc pour une Église christocentrée (théocentrée, régnocentrée) et cosmocentrée, pour une Église servante et pauvre (selon l’expression de Congar).
1. La mission de Jésus
Développons cette prise de position en commençant par l’origine même de l’Église : Jésus de Nazareth. Qu’est en effet l’Église, si ce n’est la communauté des disciples de Jésus à travers le temps ?
11. L’Incarnation
Si l’on croit que Jésus est le visage humain du Fils (Verbe) de Dieu, on professe par le fait même un extraordinaire effacement et dessaisissement de Dieu dans l’incarnation de son Fils. Dieu se vide de lui-même (kénose) pour devenir ce qu’il n’est pas (sa création) : il se vide de sa gloire divine pour se faire humain, pour entrer humblement et incognito dans le monde, un monde inconnu, qu’il ne connaît pas de l’intérieur, pour entrer dans une humanité qu’il ne connaît pas de l’intérieur, avec sa part de pulsions et de désirs corporels inconscients et donc largement incontrôlables. « Jésus Christ, lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une proie à saisir d’être l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devant semblable aux hommes, et, par son aspect, il était reconnu comme un homme ; il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé… » (Ph 2, 5-11) « Le Verbe était Dieu… Et le Verbe fut chair et il a habité parmi nous… Personne n’a jamais vu Dieu ; le Fi
Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques
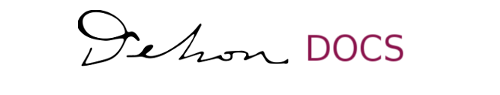




Recherche
Les derniers ajouts
Succès d'examen

Ces jours-ci, les Frères Pierre Tran et Antoine Do de la communauté dehonienne de Paris ont terminé avec succès leurs études de philosophie et de... Tout l'article
- Ascension du Seigneur
- Les forces de l'argent et du mal ne seront pas toujours vainqueurs...
- Vient de paraître - le Tome IV de la Correspondance de l'abbé Grégoire - Edition Jean Dubray
- In memoriam Père Paul Birsens SCJ
- Neues Buch von Michel Colince Kamdem SCJ
- In memoriam Fr. Pierre Rassarie scj
- Lettre du Général des Prêtres du Sacré-Coeur pour Pâques en période de pandémie
- Accompagnement pour la semaine sainte
- Accompagnement pour la semaine sainte


