Dieu étant... Diverses Perspectives, lu par Paul KREMER
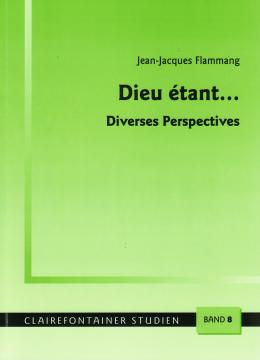
A propos de
"Dieu étant...
Diverses perspectives"*
Le père Jean-Jacques Flammang se présente, dans ses publications comme dans ses propos d’homme à homme, comme un catholique convaincu. Il défend une ligne « pure et dure ». Il le fait ouvertement, honnêtement. Il ne cache pas « son jeu » : d’ailleurs il n’y a pas lieu de parler de « jeu ». L’enjeu – si vous permettez le jeu de mots – est des plus sérieux pour qui cherche le salut et pour tous ceux qui, philosophes, entendent voir clair dans leur propre discours, comme dans celui des autres (p.ex. dans celui que mène l’Eglise catholique). Précisons : une église catholique qui, à l’instar du pape actuel cherche à trouver des fondements rationnels, « argumentatifs » comme disent les Allemands, pour la plausibilité d’une Foi qui dépassera toujours la simple raison humaine, ainsi que l’a montré avec brio le grand Thomas d’Aquin.
Nous admettrons au préalable que tous les non-catholiques ne se retrouvent pas dans le chœur des philosophes sous-mentionnés. Nous savons que bien des penseurs contemporains, fatigués par des joutes oratoires qu’ils jugent dépassées, renoncent à se poser les grandes questions que Kant attribuait à la nature humaine. Elles gravitent autour des questions apparemment usées telles que : « Qui sommes-nous ? » « D’où venons-nous ? » « Où allons-nous ? »
Un philosophe digne de ce nom devrait ne pas renoncer à reprendre des questions jugées galvaudées, même si l’histoire des 18e, 19e et 20e siècles paraît le suggérer. D’abord l’intérêt de la philosophie, l’intérêt de la recherche de clarté par les moyens de la réflexion s’y oppose. Ensuite la réalité de la vie de tous les jours nous montre que si la philosophie et/ou la/les religions négligent ces questions angoissantes, d’autres en font leurs choux gras et proposent des solutions souvent triviales, trompeuses ou déviantes. –
Avant de passer au sujet du livre, revoyons quelques pseudo-vérités établies.
D’aucuns affirment que la religion est ou devrait être une affaire dite privée. L’Etat n’aurait pas à s’emmêler. – Cette position est claire et nette. N’empêche qu’elle est contraire à la réalité et à la « nature » de la religion – si nous employons le terme au sens que lui prête la philosophie depuis le début de l’avant-dernier siècle. – Le monde arabe ne (re)connaît guère l’idée d’une religion qui soit simple « affaire privée » et d’après la motion communément admise, la religion est, entre autres, un système d’énoncés visant à élucider, précisément, les « dernières » questions que bien des hommes se posent.
Deux autres prétendues vérités seront plus difficiles à évacuer. Elles constituent l’arrière-fond sur lequel évolue la pensée du père Flammang. Aussi entrons-nous au vif du sujet quand nous rappelons la thèse qui voit dans l’homme un animal à part sans toutefois lui reconnaître une spécificité essentielle. Cette thèse fut défendue avec énergie, finesse et compétence par un Luxembourgeois travaillant et connu en France, dont il a adopté la nationalité : Jean-Marie Schaeffer de Clervaux, directeur-chercheur au CNRS à Paris. « La fin de l’exception humaine », un essai volumineux paru en 2007, soutient cette thèse. Quelques mois plus tôt un autre Luxembourgeois, moins connu, avait envisagé, à titre de simplification discursive, de négliger tout simplement le phénomène encombrant de la conscience. Dès lors serait facilitée la réduction du statut de l’homme à celui d’un vulgaire animal, alors que toute la philosophie occidentale depuis Aristote (4e s. av. JC), a accentué la différence de l’homme, animal pensant, par rapport aux autres. Pour le père Flammang le fait de la pensée (humaine) reste unique. Aucun autre animal n’y accède et même si la science paraît suggérer que la distance entre l’homme et – mettons – le bonobo s’amenuise, l’écart essentiel restera : le scientifique qui établit le rapprochement entre l’homme et le singe est, et reste un homme. Aucun bonobo n’aura jamais la moindre « Ahnung » (mot intraduisible en la langue de Voltaire) d’un tel discours scientifique.
La deuxième pseudo-vérité rejoint la remarque faite plus haut qui parle de la fatigue ou de la paresse – à moins qu’il ne s’agisse d’une mauvaise foi travestie… - qui s’accommode d’un agnosticisme théorique – « je ne sais pas si Dieu existe, ni d’ailleurs le contraire » accompagné d’un relativisme moral, béat – « d’ailleurs : qu’est-ce que ça fait qu’Il existe ou non ? Et puis voyez l’Histoire des aberrations religieuses… » - Les milieux intellectuels occidentaux, instruits par la « verschmitzt kluge Skepsis » de Kant (dixit Nietzsche) ont tendance à laisser le Bon Dieu aux hommes de l’Eglise et préfèrent volontiers se cantonner dans un agnosticisme accommodant. –
Ceci dit, que nous apprend le père Flammang ?
Avant de parler, il se met à l’écoute. « Dieu étant… » est une collection d’articles en partie parus à la « Warte ». Ces articles sont autant de comptes rendus de nouvelles publications, en général dues à la plume d’hommes croyants qui cherchent des voies nouvelles, « argumentatives », pour sortir le catholicisme de l’isolement théorique qui l’a caractérisé, aux yeux de l’opinion publique « éclairée », pendant des décennies.
Les livres parus articulent le plus souvent des réflexions qui tournent autour des deux problématiques entamées : y a-t-il une spécificité, une exception humaine, compte tenu des derniers résultats affichés par la science en la matière – et : le champ des religieux mérite-t-il de rester cloîtré dans le domaine d’une foi plus ou moins aveugle à l’instar de celle du père Paneloup ou faut-il en sortir et relever le gant du duel discursif comme l’a fait le grand St. Thomas, il y a sept ou huit siècles ? – Il s’y ajoute un 3e aspect : si l’éthique ne veut pas rester une éthique du seul choix, absurde d’après le modèle existentialiste sartrien ou camusien, ne doit-elle pas se chercher un fondement en-dehors des vérités de la chimie et de la physique, disciplines quasi-totalitaires ? En d’autres mots : un fondement métaphysique ne s’impose-t-il pas pour libérer « la vérité captive » de Maxence Caron ?
Revoyons le premier point ! – La thématique de la spécificité ou de l’ « exception » humaine remonte à Aristote. Il dit à peu près ceci : L’homme naît, croît, procrée et meurt – comme une plante qui vit et qui disparaît. – L’homme voit, entend, goûte et se meurt, comme un animal « courant ». L’homme voit « avec » les yeux ; il entend « au moyen » des oreilles : les « organes » des sens sont, étymologiquement, des outils, des instruments, « Werkzeuge ». – Or, au niveau 3 de cette constitution de l’être/de l’âme vivante, au niveau spécifiquement humain, la pensée, dont le modèle sera longtemps la pensée mathématique, fonctionne de façon « selbsttätig » - c.à.d. sans recours à un organe corporel – ce que nous, hommes du XXIe siècle, n’acceptons plus guère quitte à reconnaître que le phénomène de la conscience n’a pas de support physique : en évoquant la/ma conscience, je parle autrement que quand j’évoque la vue ou l’ouïe ; les résultats de la vue ou de l’ouïe peuvent être re-produits ou stockés matériellement (appareil-photo, i.pod etc.) ; il n’en restera pas moins vrai que ni l’appareil-photo ni l’i.pod n’ont conscience du cliché pris ou des sonorités jouées. La conscience est « sui generis » ; elle se maintient irréductible à la matière qui est le sujet d’investigation de la physique et de la chimie.
Pourquoi l’importance de ces remarques pour le père Flammang ? Et pour le philosophe de la vieille école ? Pour le père Flammang et les auteurs comme Francis Wolff : parce que la réflexion qui déblaye un territoire autonome de la conscience, ni balisé ni viabilisable par la pensée physico-chimique, ouvre par là une réserve à part dans l’être, dans le paysage des choses qui sont. « Autre chose » que le mesurable-productible pourra s’y installer. Une transcendance entrera par la brèche où sera pratiquée dans la construction scientifique qui entend disposer de tout et remodeler tout. Bref : pris en charge par l’homme, l’Etant s’y verra face-à-face avec l’Etre qui le dépasse infiniment : « Dieu étant… »
Le 2e gant que le père Flammang relève est celui, quasiment donquichottesque, de la lutte contre les moulins à vent des relativisme et scepticisme régnants. L’Occident philosophique s’arrange apparemment de toute « vérité » aussi longtemps que la paix politique et sociale ne s’en trouve pas altérée. Ce laisser-aller, ce laisser-faire n’est toutefois ni innocent ni anodin ni même – ce qui est autrement grave – logiquement consistant. Nous autres logiciens, élèves appliqués de B. Russell et de A.N. Whitehead, auquel dernier J.J. Flammang a d’ailleurs consacré une étude remarquable, savons que le Crétois – sinon le Grec tout court – n’est pas un menteur qui s’avoue , comme le suggère mon patron St. Paul. Dire : « Je mens » implique une contradiction au niveau de l’énoncé même : si j’avoue mentir, je dis vrai. Comment dès lors mentirais-je ? – Pour plus de détails, prière de relire le début des Principia Mathematica des deux Britanniques susmentionnés.
Le pape actuel l’avait bien vu. Le sceptique, dominateur et sûr de lui comme le juif gaulliste, s’abîme dans la contradiction : Hegel l’avait compris avant de rédiger le chapitre suivant de ses Phénoménologies, celui de la Conscience malheureuse qui est celui de la Foi.
Soyons plus clairs !
Le sceptique ne peut, honnêtement, ni continuer à penser/parler ni même à vivre. Vivre, c’est vivre sur des assurances, fussent-elles passagères : je bois de l’eau et non un poison camouflé en eau minérale. L’homme vit sur des assurances assez solides pour lui permettre raisonnablement le style de vie, le « way of life » qui est le sien.
Or, toute assurance, toute morale donc, exige, aux yeux du philosophe, un fondement. Du fondement il n’y en a, à vrai dire, que d’un type : le fondement sera un énoncé jugé définitif – ou choisi comme tel, si l’on se contente d’être un élève de Sartre ou de Camus.
Est-ce que tous les choix se valent ? En bonne logique : oui. Sauf qu’il y aura un ajout : pour nous, qui sommes des êtres qui vivons et qui entendons continuer à vivre, la seule logique ne suffit manifestement pas à meubler notre univers discursif, qui sera aussi notre univers vécu. Dès lors le père Flammang voit bien que la réponse catholique est, certes, d’abord un choix envisageable. Par ailleurs et en allant plus loin, ce choix éclairera d’un jour nouveau le brouillard moral dans lequel les hommes postmodernes cherchent un sens à l’existence humaine. – La musique p.ex. y retrouve la place définitive ; nous nous rappelons que la grande musique occidentale était – et continue d’être… - une musique sacrée et non, comme « hélas » dirait Gaston Carré, une sacrée musique. –
Arrêtons-nous ici ! – Mon dessein n’était pas de redire en de mauvais termes ce que J.J. Flammang a dit en une langue claire et nette et qui ne mélange jamais Raison et Foi. Mon dessein était de montrer que les esprits curieux à la fois du pensé et du sacré trouvent dans « Dieu étant… » matière à ample réflexion personnelle.
Quel plus beau compliment à rendre à un esprit à la fois religieux et philosophique ?
Paul Kremer, philosophe, Président de la Commission nationale d'éthique, Luxembourg
(*) Jean-Jacques FLAMMANG : Dieu étant... Diverses Perspectives (Clairefontainer Studien Band 8), Clairefontaine, Heimat und Mission, 2011, 158 pages. ISBN 978-2-9599706-3-4. Prix 17,20 euros. Le volume peut être commandé en versant le montant de 17,20 € sur le compte postal : CCPLLULL LU07 1111 0137 5982 0000, avec la mention : « Clairefontainer Studien Band 8 »
Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques
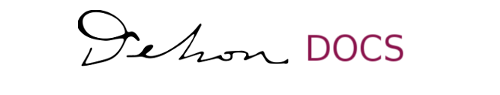

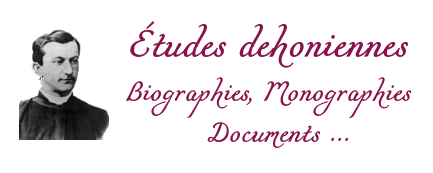


Recherche
Les derniers ajouts
Succès d'examen

Ces jours-ci, les Frères Pierre Tran et Antoine Do de la communauté dehonienne de Paris ont terminé avec succès leurs études de philosophie et de... Tout l'article
- Ascension du Seigneur
- Les forces de l'argent et du mal ne seront pas toujours vainqueurs...
- Vient de paraître - le Tome IV de la Correspondance de l'abbé Grégoire - Edition Jean Dubray
- In memoriam Père Paul Birsens SCJ
- Neues Buch von Michel Colince Kamdem SCJ
- In memoriam Fr. Pierre Rassarie scj
- Lettre du Général des Prêtres du Sacré-Coeur pour Pâques en période de pandémie
- Accompagnement pour la semaine sainte
- Accompagnement pour la semaine sainte


