ALUC 1910-2010
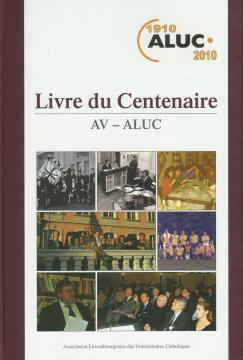
Pour le Centenaire de l’ALUC
Entrer sur la place publique
La modernité et la sortie de la religion
Pour ne pas employer les mots de sécularisation ou de laïcisation, mots piégés, car d’origine ecclésiale désignant ce qui n’est pas d’église ou ce qui sort de sa juridiction, on se sert aujourd’hui volontiers de cette expression imagée « sortie de la religion ». Elle serait plus explicative du phénomène moderne de la diminution et de la marginalisation, ou encore simplement de la quasi-disparition du rôle du religieux dans le social, le politique, la culture et la pensée.[1]
Alors que les notions de sécularisation et de laïcisation se sont formées et ne se comprennent qu’à partir de l’omniprésence du religieux qui les définit, la sortie de la religion semblerait mieux rendre compte du caractère aléatoire de cette dernière. Elle pourrait sortir de la culture moderne, et celle-ci continuerait à évoluer, quitte à ce qu’elle se réorienterait autour d’un autre attracteur à déterminer au fur et à mesure que la religion en occurrence chrétienne s’éclipserait.
Aussi intelligente que cette notion de sortie de la religion puisse paraître, il ne reste pas moins qu’elle est ambiguë : on peut sortir pour disparaître ou sortir pour se montrer. Dans quel sens faut-il comprendre la sortie de la religion si on veut par elle vraiment comprendre l’orientation de la modernité ? La religion sort-elle en ce sens qu’elle quitterait la culture moderne, ou bien au contraire, sort-elle de sa présence évidente pour se montrer et devenir objet de réflexion et de débat publique ?
A supposer que sortir voudrait bien dire quitter, où alors la religion chrétienne se rendrait-elle en quittant la modernité ? Trouverait-elle une autre terre d’accueil ou disparaîtrait-elle tout simplement et pour de bon ? Cette dernière hypothèse a souvent été émise par des visionnaires modernes. Dieu est mort, et pourtant le cadavre bouge toujours, un peu comme la fin du monde périodiquement prédite par les Témoins de Jéhovah. Chaque fois on y est presque, mais chaque fois la disparition définitive échoue. Cette différance semble constitutive de ce qu’on appelle la modernité. Même si certaines Eglises ou communautés religieuses perdent de leurs effectifs, cela n’est pourtant pas une raison suffisante pour parler de disparition de la religion comme telle.
D’autre part, depuis que nous savons que les civilisations sont mortelles se pose anxieusement cette question : la sortie de la religion chrétienne hors des sociétés modernes ne serait-elle pas le signe prémonitoire de la mort imminente de la civilisation moderne ?
Les sirènes de l’autonomie avaient fait croire que la sortie de la religion serait un avantage et renouvellerait de fond en comble la culture en accentuant la force émancipatrice de cette liberté que l’homme se donnerait lui-même et qui le sortirait de toute dépendance religieuse jugée néfaste.
S’il est faux de nier les bienfaits de la culture moderne qui a permis un exercice plus conséquent de la liberté, il faut pourtant déplorer au niveau philosophique son incapacité à dire l’origine et l’ancrage de cette liberté.
Toute la philosophie post-Aufklärung s’est efforcée de penser le fondement de la liberté sans pouvoir y parvenir. Il y a certes les spéculations de l’idéalisme allemand, mais son absolu qui se constitue dialectiquement à partir du néant n’arrive pas à se faire passer comme véritable absolu. Il y a aussi toute la littérature perspectiviste autour de la mort de dieu, d’une liberté engagée, d’une existence qui précéderait l’essence, d’une structure auto-structurante ou d’une épistémologie anarchique « ni dieu ni mètre ». Il y a même cette liaison forte, mais non justifiée, entre être et temps qui essaie de barrer tout accès à une prise en considération de l’être infini. Mais tous ces essais pour fonder ou justifier la liberté soulèvent plus de questions qu’ils n’en résolvent.
Force est de constater que la pensée moderne n’a tout simplement pas réussi par ses propres moyens à ressaisir la liberté humaine en sa source. Négligée comme un simple fait, la réflexivité qui la fonde est ou bien intégrée à ce qui est en réalité en deçà d’elle, comme chez Descartes, Kant, Nietzsche ou Heidegger, ou bien mise elle-même au pinacle sans que son fond ontologique soit véritablement dégagé, comme chez Fichte, Hölderlin, Hegel ou Husserl.
Ce constat philosophique a amené Maxence Caron[2] à écrire un nouveau système de la philosophie et de son histoire en retraçant de façon incisive l’oubli de la Différence fondamentale et les nouvelles voies qui permettent de la penser à nouveau. Le résultat de ses recherches permet de conclure que toute pensée appelle structurellement et effectivement ce dont témoigne la religion, et sa sortie de la culture moderne signifierait à long terme la mort de celle-ci.
A moins que sortir ne veut pas dire disparaître, mais se montrer.
Il est vrai que dans les cultures a-modernes la religion ne sort pas pour se montrer. Elle est là, omniprésente, jusque dans les structures et l’organisation interne des constituants culturels dont elle est le principe de cohérence. Seul le contact avec d’autres façons de la concevoir fait parler de la religion en tant que telle. Si de nouvelles religions réussissent à s’intégrer dans une telle société, il n’y a pas de danger pour sa culture. Si par contre une nouvelle forme de religion s’impose au point de combattre, voire d’éliminer l’ancienne, la culture en sera profondément affectée et pourrait même faire disparaître la civilisation dont elle est issue. Le cours de l’histoire humaine se souvient de telles disparitions comme par exemple en l’antique Grèce ou en Egypte, chez les Incas ou chez les Mayas.
La civilisation moderne aurait-elle à subir un sort comparable, une fois sa religion bannie de l’espace culturel ? La sortie de la religion entraînerait-elle à la longue la disparition de la modernité elle-même?
Le concept « sortie de la religion » forgé pour décrire et interpréter la modernité et le statut spécial qu’y aurait la religion n’a de véritable pertinence que si par sortie on n’entend pas abandon, mais bien manifestation. Il reste à établir la justesse d’une telle compréhension.
Dans la culture moderne, la religion loin de disparaître a plutôt tendance à se montrer. Contrairement aux cultures a-modernes, la modernité par sa critique de la religion assigne à celle-ci une place explicite en la faisant sortir de sa présence tacite. Critiquée par ceux qui la veulent faire disparaître, la religion exerce elle-même une fonction critique par rapport à cette culture dont elle fait partie et qu’elle a en dernière analyse initiée. La modernité favorise donc bien une sortie de la religion, en se sens qu’elle la prend explicitement en considération, même si c’est dans son intention de la faire sortir de la place publique, surtout si, critique, la religion continue à faire signe vers l’origine oblitérée de la modernité. Le débat non clos autour des racines chrétiennes de la culture européenne témoigne de ce sens de la sortie de la religion dans la modernité.
Plus la société se modernise, plus elle s’ouvre aux diverses formes de religion. Cette ouverture lui est dictée d’une part pour le bon fonctionnement économique vue sa faible croissance démographique et d’autre part à cause de la place prépondérante que la modernité accorde à la liberté et donc au pluralisme et à une relative tolérance vis-à-vis des idées diverses. En accueillant l’autre qui vient, la modernité appelle sa religion à se manifester et à sortir sur la place publique.
Mais cet appel à la sortie est lui-même ambigu. Et c’est là le paradoxe inhérent à la modernité. D’une part sa liberté fondatrice l’invite à s’ouvrir aux autres dans un dialogue tolérant et constructif ; elle a besoin de cette ouverture pour continuer son projet qui se veut universel. Mais d’autre part, l’hésitation sur le fondement de sa liberté lui dicte un pluralisme relativiste qui l’enferme en elle-même et la rend incapable d’une sortie authentique vers l’autre qui pourtant la constitue.
Ce paradoxe n’est qu’une des multiples variantes autour du paradoxe fondamental du christianisme : l’Incarnation. Dieu fait homme, foi et raison, politique et morale, fini et infini, liberté et grâce, action et contemplation, disparition et manifestation, immanence et transcendance, venue et sortie. Tant que par une sortie la religion advient dans la modernité, celle-ci continue à vivre de son paradoxe. En sortant d’une évidence tacite, la religion fait signe vers l’origine de ce qui constitue la liberté moderne et qui se comprend philosophiquement à partir de la Différence fondamentale.
Dieu ne cesse de réapparaître là même où lui est refusé le droit d’être. Essentiellement liée au projet de la modernité, la religion chrétienne ne disparaîtrait que dans l’exacte mesure où cette modernité disparaîtrait à son tour. Or la modernité vante à juste titre sa pérennité et son universalité. N’est-ce pas elle qui a entamé la mondialisation en établissant des relations avec toutes les cultures a-modernes ?
Face à ceux qui prédisent pour l’avenir de l’humanité des chocs et des batailles entre civilisations, d’autres envisagent plutôt une marche de l’humanité vers sa fin, son but ultime, une société réconciliant des libertés individuelles dans un projet politique mondial. N’exige-t-on pas à partir des droits de l’homme formulés sur la base d’une compréhension chrétienne et moderne de la dignité humaine un fonds de valeurs communes à respecter partout sur le globe terrestre ?
Et pour ce faire, le pape Benoît XVI propose même dans son encyclique sociale « que soit mise en place une véritable Autorité politique mondiale (…) qui devra être réglée par le droit, se conformer de manière cohérente aux principes de subsidiarité et de solidarité, être ordonnée à la réalisation du bien commun, s’engager pour la promotion d’un authentique développement humain intégral qui s’inspire des valeurs de l’amour et de la vérité. Cette Autorité devra en outre être reconnue par tous, jouir d’un pouvoir effectif pour assurer à chacun la sécurité, le respect de la justice et des droits. Elle devra évidemment posséder la faculté de faire respecter ses décisions par les différentes parties, ainsi que les mesures coordonnées adoptées par les divers forums internationaux. En l’absence de ces conditions, le droit international, malgré les grands progrès accomplis dans divers domaines, risquerait en fait d’être conditionné par les équilibres de pouvoir entre les plus puissants. Le développement intégral des peuples et la collaboration internationale exigent que soit institué un degré supérieur d’organisation à l’échelle internationale de type subsidiaire pour la gouvernance de la mondialisation et que soit finalement mis en place un ordre social conforme à l’ordre moral et au lien entre les sphères morale et sociale, entre le politique et la sphère économique et civile que prévoyait déjà le Statut des Nations Unies. » (Caritas in Veritate, 67)
Cette mission que se donne la modernité dans un monde de plus en plus globalisé n’est pas sans rappeler l’esprit missionnaire de l’Evangile qui en reste sa source implicite. Tout reniement explicite de cette origine chrétienne par un athéisme plus ou moins fondamentaliste n’arrive pas à faire disparaître la religion. Et tout fondamentalisme religieux n’arrive pas à éliminer la liberté critique inhérente au projet moderne et à toute véritable religion.
Loin de disparaître de la modernité ou de nuire à la bonne marche de l’humanité, la religion chrétienne ne cesse d’y apparaître pour aider la liberté moderne à se libérer tant de fausses illusions que du mépris qu’elle subit du fait qu’elle ne peut se ressaisir en sa propre origine. Les illusions lui font croire que par « la sortie de la religion » caractérisant la modernité, on devrait comprendre la mort de dieu et la disparation de toute religion alors que le mépris de la liberté essaie de la nier dans des régimes politiques totalitaires qu’engendre périodiquement une modernité pas suffisamment vigilante et consciente de son paradoxe et de sa source.
Pour favoriser la sortie de la religion, cette fois-ci comprise comme manifestation et engagement critique de la foi chrétienne dans la vie publique moderne, quinze étudiants catholiques luxembourgeois s’étaient rassemblés le 7 août 1910 dans la Maison du Peuple à Luxembourg-Ville et y ont fondé ce qui devait devenir l’ALUC, l’association luxembourgeoise des universitaires catholiques. Dans leurs activités estudiantines, syndicales, politiques et culturelles, il leur semblait évident que l’apport religieux de leur foi serait de première importance pour la bonne marche d’une société en évolution. Loin de cacher leur catholicisme ou de l’abandonner, l’ALUC a au contraire tout au long des cent dernières années réussi à le défendre dans ces valeurs qu’elle s’est données comme devise : Fides, scientia, amitia, patria.
Puisse cet engagement sociétal continuer ad multos annos !
P. Jean-Jacques Flammang SCJ
[1] Cf. Marcel Gauchet : La religion dans la démocratie.Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998.
[2] Maxence Caron : La Vérité captive. De la philosophie. Système nouveau de la philosophie et de son histoire passée, présente et à venir, Théologiques, Paris, Les Editions du Cerf / Ad Solem, 2009.
Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques
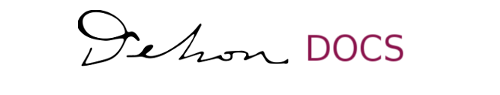




Recherche
Les derniers ajouts
Succès d'examen

Ces jours-ci, les Frères Pierre Tran et Antoine Do de la communauté dehonienne de Paris ont terminé avec succès leurs études de philosophie et de... Tout l'article
- Ascension du Seigneur
- Les forces de l'argent et du mal ne seront pas toujours vainqueurs...
- Vient de paraître - le Tome IV de la Correspondance de l'abbé Grégoire - Edition Jean Dubray
- In memoriam Père Paul Birsens SCJ
- Neues Buch von Michel Colince Kamdem SCJ
- In memoriam Fr. Pierre Rassarie scj
- Lettre du Général des Prêtres du Sacré-Coeur pour Pâques en période de pandémie
- Accompagnement pour la semaine sainte
- Accompagnement pour la semaine sainte


