Le taoïsme
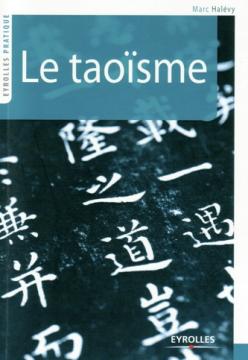
A propos du livre de Marc Havély
Le taoïsme
La sagesse de l’ici et maintenant
« La vie est ici et maintenant : ni dans le passé, dans le futur, ni dans l’au-delà. Elle n’est QUE là, dans chaque instant. A force de vivre pour demain, l’on ne vit jamais réellement : or seul « maintenant » est réel, car demain ne sera peut-être jamais. » [1]
C’est sur cette confession que se termine le livre par lequel Marc Halévy initie le lecteur au taoïsme, cette sagesse-remède pour le XXIe siècle à la recherche d’une « après-Modernité » dont le Tao-chia, la pensée-sagesse taoïste, pourrait devenir le ferment.
Scientifique de haut niveau qui fait de la recherche fondamentale en physique autour des processus complexes tout en se spécialisant en philosophie et histoire des religions, Marc Halévy fait sur notre époque un constat qui n’est pas nouveau ; on l’a déjà entendu ailleurs, mais cela ne lui enlève rien de sa pertinence : « La Modernité, entamée par les humanistes de la Renaissance, formalisée par les rationalistes classiques, exacerbée par les prétentions des Lumières, gonflée par les positivistes et démentie par toutes les catastrophes humaines et écologiques du XXe siècle, s’effondre sous nos yeux. Il s’agit de fonder une après-Modernité. De réconcilier l’homme et la Nature, la raison et l’intuition, le réel et le sacré, le corps et l’esprit, l’action et la paix, le temps et la durée, la vie et la peur, la parole et l’acte, le cœur et la main… Il faut en finir avec tous les dualismes artificiels dont l’Occident est pétri et qui le détériorent toujours plus. »
Pour ce faire, Marc Halévy informe sur le taoïsme, cette sagesse chinoise ancienne et toujours nouvelle qu’il juge à même d’indiquer une issue vers une après-Modernité plus réussie et plus heureuse.
Son livre, clairement structuré et fort pédagogique, présente d’abord brièvement l’histoire du taoïsme, puis l’idée de tao et la conception du sage qui en découle, le tout en rapport avec ce qui est pour lui la culture occidentale.
La pensée chinoise est largement influencée par les deux grands courants que sont le taoïsme et le confucianisme. Le taoïsme s’élabore à partir de la terre et de son chaos qui rend impossible et inutile la recherche d’un ordre dans un ailleurs. D’essence moniste, il fait comprendre l’homme comme une partie de la Nature, entre Ciel et terre. Entrer en harmonie dès maintenant ici, c’est là la fin de la sagesse taoïste, alors que le confucianisme apprend à établir et respecter des règles strictes et rigoureuses du ciel pour atteindre un jour à l’harmonie recherchée dans l’infini et l’éternel.
Trois noms, trois livres
La sagesse qui recevra le nom de taoïsme a d’abord été développée par le grand maître Lao-Tseu dans cet écrit qui nous est parvenu en 81 chapitres sous le titre de « Tao-Tö King ». Cette sagesse ou philosophie se dit en chinois Tao-chia. Une fois le confucianisme devenu doctrine officielle, la sagesse taoïste se transforme et survit dans une espèce de religion magico-alchimiste, en chinois Tao-chiao, avec son clergé, ses rites, ses prières, ses moines, ses doctrines.
Sur l’insertion historique de Lao-Tseu on hésite : d’aucuns le voient dans le fameux VIe siècle, « avant l’ère vulgaire », comme s’exprime Marc Halévy. Nous préférons dire avant Jésus-Christ, ce qui est plus juste et aussi du point de vue de la marche de la pensée beaucoup plus signifiant. Ce VIe siècle avant Jésus Christ a vu naître les grands prophètes de l’Ancien Testament en Palestine, Bouddha et les rédacteurs des Upanishads en Inde, Zoroastre en Perse. C’est peut-être pour ajouter à ces grands de la pensée humaine que l’on situe aussi Lao-Tseu en ce siècle fameux. D’autres le voient mieux placé au IVe siècle avant Jésus-Christ où on le retrouverait avec Tchouang-Tseu, le second philosophe taoïste, auteur du fameux livre en trente-trois chapitres qui porte comme titre le nom de son auteur «Tchouang-Tseu ».
Peu importe, c’est encore avant Jésus-Christ où le sens de l’histoire n’a pas cette importance que lui donnera la résurrection. Toujours est-il que Tchoung-Tseu influencera les écoles Ch’an qui donneront quelques siècles plus tard le Zen au Japon et en Corée, ce Zen que Marc Halévy décrit comme « du tao saupoudré d’un tout petit peu de Bouddha ».
Alors que le Tao-Tö King est plus abstrait et plus métaphysique dans son élaboration, le Tchouang-Tseu redit les mêmes vérités en paraboles, allégories et petites histoires. Ce qui fait dire Marc Halévy que Lao-Tseu parle au cerveau gauche et Tchouang-Tseu au cerveau droit, la sagesse des deux présentant un certain détachement et une liberté quasi anarchique, cynique et sceptique : « du réel, on ne peut rien dire sinon ce qu’il n’est pas ».
Le troisième sage dont on ignore s’il a vraiment vécu est Lie-Tseu. On lui attribue « Le Vrai Classique du Vide Parfait », un livre qui est peut-être écrit par Tchouang-Tseu. On y retrouve les deux veines du taoïsme, métaphysique et allégorique. Par vide, il ne faut pas comprendre simplement le néant ou le rien, mais bien une vacuité, une absence de contrainte factice et d’encombrement, une tendance à une plus grande simplicité et à la frugalité maximale. Cette façon de voir entraîne un mode de vie, une ascèse, une praxis solidement ancrée dans le réel qui procure une joie de vivre chantée par de nombreux poèmes chinois. Cette ivresse est quasi mystique et vécue par l’homme qui sort de lui-même pour se plonger dans le tao cosmique, « fusion totale et joyeuse avec le réel ici et maintenant ».
L’idée et la sagesse de tao
En explicitant les notions fondamentales, Marc Havély a réussi à donner de façon pédagogique une idée claire de ce que nous mettons sous le nom de taoïsme. Et d’abord la notion de Tao elle-même. Souvent traduite par « voie », il vaudrait mieux dire « processus créatif » dont tout émane, sans plan préétabli, car tout est relatif et impermanent. La vérité n’existe pas, seul le réel, caché sous les apparences, existe. Et l’homme doit dépasser les perceptions de ses sens pour s’en rendre compte.
Le Taï-yi est l’unité manifestée et suprême, la face visible du tao. Il est le Un qui englobe tout et engendre tout. Chaque situation, chaque ici et maintenant contient du yin et du yang. Le yang est le processus d’émergence, d’organisation, de construction, alors que le yin est le processus d’aplanissement, de dilution, d’apaisement. L’articulation des énergies dans un système est le perpétuel jeu d’équilibrage du yin et du yang. Le Taï-chi est la loi d’harmonie entre les deux qui ne s’actualisent que dans leur conjonction, c’est-à-dire dans ce Trois qui unit le Deux dans un nouveau Un.
S’opposant foncièrement au dualisme, le taoïsme est ternaire ; pour lui, tout est triade. Dans sa cosmologie, il retient cinq éléments : eau, feu, métal, bois et terre qui se nourrissent les uns des autres et se détruisent, en suivant des cycles précis. Cette circularité confère à l’univers une fluidité qui est reflet du tao, lui-même fluidité, mouvement et transformation.
Une autre notion, c’est le wu-weï, que l’on pourrait traduire par « non-agir » ou plutôt par « non-violence » et « parfaite adéquation ». Il ne s’agit pas d’un combat entre bien et mal, mais de faire bien ce qu’il y a à faire ici et maintenant. De cette attitude découle le fondement de tous les arts martiaux : ne pas dépenser son énergie, mais retourner ou détourner celle de l’adversaire.
Enfin par Fu, il faut comprendre que tout retourne toujours à sa racine. Il existe une réalité qui dépasse l’homme, l’englobe et le transcende infiniment, et cette réalité est la seule source de son existence et du sens de cette existence. Il n’est pas ici question de salut comme dans les religions occidentales, mais bien de libération des illusions et des apparences. L’homme est appelé à se détourner de l’ego et à s’en retourner vers le tao.
De cette cosmologie présentée comme une métaphysique de la réalité découle toute une sagesse du tao qui valorise le naturel, la simplicité, l’harmonie, le détachement, la frugalité, la spontanéité et la longévité. Le « saint » taoïste n’a que très peu avoir avec son homologue chrétien. Charité, amour du prochain, sacrifice, abnégation, don de soi n’ont pour lui aucun sens. Le moi étant une illusion, le sage taoïste n’a pas besoin des autres, mais construit lui-même sa propre médiation verticale entre ciel et terre. « Il a atteint le point Oméga de Teilhard de Chardin. Il est devenu le Surhomme de Nietzsche. »
Le tao et la pensée occidentale
Tout au long de son exposé fort pédagogique, l’auteur fait des références à la culture occidentale qu’il croit opposée au taoïsme. Alors que ce dernier est mouvement et unité, organique et cosmocentrique, la pensée occidentale serait foncièrement dualisme et violence, mécaniste et anthropocentrique. Par pensée occidentale, Marc Halévy comprend surtout une certaine philosophie moderne à laquelle il assimile sans plus le christianisme.
Mais le lecteur aura du mal à voir comment saint Augustin peut être rangé parmi les dualistes, lui qui justement quittait le manichéisme dualiste pour devenir chrétien. Parler à la fois du surhomme de Nietzsche et du point oméga de Teilhard de Chardin pour valoriser les deux en rapport avec la pensée de tao, c’est original, mais affirmer que « l’aileron de requin (dans le culte tao-chiao) a remplacé l’hostie d’ici, voilà tout » est-ce vraiment saisir le sens de l’hostie et des différences cultuelles ?
Pour un dialogue entre le christianisme et la pensée taoïste, il serait sans doute enrichissant d’approfondir davantage le dogme chrétien de la Trinité et la doctrine de l’homme, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Une prise en compte de la riche pensée médiévale montrant dans le christianisme d’autres ressources qu’un certain dualisme présent dans la philosophie moderne pourrait elle aussi ouvrir un espace pour une rencontre plus constructive entre pensée occidentale et taoïsme.
P. Jean-Jacques Flammang SCJ
[1] Marc Halévy : Le taoïsme. Deuxième tirage 2011, Paris, Editions Eyrolles, 2009, 188 pages. ISBN :978-2-212-54407-7.
Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques
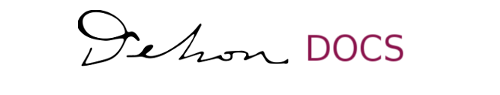

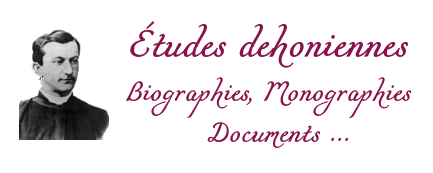


Recherche
Les derniers ajouts
Succès d'examen

Ces jours-ci, les Frères Pierre Tran et Antoine Do de la communauté dehonienne de Paris ont terminé avec succès leurs études de philosophie et de... Tout l'article
- Ascension du Seigneur
- Les forces de l'argent et du mal ne seront pas toujours vainqueurs...
- Vient de paraître - le Tome IV de la Correspondance de l'abbé Grégoire - Edition Jean Dubray
- In memoriam Père Paul Birsens SCJ
- Neues Buch von Michel Colince Kamdem SCJ
- In memoriam Fr. Pierre Rassarie scj
- Lettre du Général des Prêtres du Sacré-Coeur pour Pâques en période de pandémie
- Accompagnement pour la semaine sainte
- Accompagnement pour la semaine sainte


