Le christianisme en refondation
Recension du livre
Yves Ledure scj
Le christianisme en refondation
Desclée de Brouwer, Paris, 2002, pp. 213, € 19
Le christianisme peut-il encore avoir une place dans nos sociétés modernes de plus en plus indifférentes, voire hostiles à l’égard des religions?
Oui, répond Yves Ledure dans son étude fort originale qu’il vient de publier chez Desclée de Brouwer, oui, mais à condition que la modernité se comprenne davantage dans son projet anthropologique et que le christianisme renoue avec son véritable fondement, l’homme Jésus de Nazareth, Dieu incarné, mort et ressuscité.
Par son tournant anthropologique, la modernité a quitté la pensée métaphysique pour faire de l’homme le paramètre des valeurs et des interprétations: tout doit se comprendre désormais à partir de l’homme, même les religions. Ludwig Feuerbach l’a bien vu dans L’Essence du christianisme , où il montre que le signifiant du fait religieux ce n’est pas un Dieu transcendant, mais c’est l’homme. Pour se réaliser pleinement, l’homme doit donc abandonner toute aventure spirituelle qui fixerait d’avance sa destinée en posant un Dieu-Père, créateur tout-puissant, comme l’a fait l’âge métaphysique. «L’homme se perd en se liant à Dieu», voilà le nouvel axiome explicitement athée du XIX e siècle que le XX e siècle accepte comme une évidence transcendantale. Le Dieu métaphysique par lequel le christianisme s’est longtemps compris empêche l’homme de se constituer autonome, libre et responsable, selon le projet anthropologique de l’ Aufklärung . Aussi l’homme moderne devrait-il le nier pour se réaliser et se déterminer soi-même.
Dans Le christianisme en refondation , Yves Ledure montre que loin d’empêcher la détermination de soi, le christianisme plus explicitement recentré sur l’incarnation et la personne du Christ permet au contraire à l’homme de prendre la vraie dimension de sa nature. Celle-ci consiste à devenir un être libre. La liberté du projet anthropologique ne doit pas se comprendre comme un simple donné par nature, mais bien comme une exigence de réalisation qui suppose un devenir. Dans le cas de Jésus, ce devenir s’est concrétisé tout au long de son parcours historique par une attitude toujours plus consciente et affirmée de filialité vis-à-vis de Dieu. La liberté n’est donc pas un dû, mais bien un travail de libération pour faire advenir cette filialité.
Ledure dit bien filialité , et non pas filiation, comme le pensent trop souvent ceux des modernes qui présentent le dogme chrétien. Car la filialité est du registre de l’esprit, alors que la filiation s’exprime dans le schéma pouvoir-soumission que Freud a largement analysé. Dans la filiation, le fils n’existe que par le père, et pour exister par lui-même, il devrait effacer son père. Pour la dogmatique freudienne, Dieu n’est que la sublimation de ce père primitif qui maintient sous sa tutelle tous ceux qui le vénèrent. Le croyant reproduirait ainsi le statut d’une filiation de soumission, qui interdit toute autonomie et détermination de soi. En conséquence, une religion qui accentue cette filiation se met nécessairement en travers de tout projet anthropologique à la base d’autonomie et de liberté.
Si le christianisme était une telle religion basée sur la filiation, comme le font comprendre les modernes, il ne resterait pas d’autre choix que de s’en défaire aussi vite que possible pour faire advenir la liberté, Mais, à la suite des analyses de Marie Balmary, Yves Ledure montre que le christianisme authentique ne se comprend pas à partir de la filiation-soumission, vu que le dogme essentiel du christianisme affirme justement que Jésus est sans père biologique. Conçu du Saint-Esprit, le Fils n’obéit pas au schéma de la filiation freudienne, et rien dans le parcours historique de Jésus ne permet d’interpréter la relation au Père comme une substitution de la paternité divine. Au contraire, Jésus ne cesse d’affirmer qu’il ne fait qu’un avec le Père.
Pour la foi chrétienne, la figure Dieu-Père, loin d’être un en-soi fondateur, postule au contraire toujours la médiation de Jésus dans son positionnement de fils. Le véritable référent de la paternité divine est donc cette filialité qui se construit dans le parcours historique de Jésus. Ne dit-il pas à Philippe: «Celui qui m’a vu, a vu le Père»?
C’est une des richesses du livre de Ledure d’avoir mis l’accent sur cette réalité de filiation dans l’Esprit, ignorée ou occultée par tous les courants athées de la modernité.
En refusant une certaine idée métaphysique de Dieu, celle où Dieu est le créateur et l’homme sa créature soumise, l’athéisme moderne a certes libéré l’homme pour son projet anthropologique de détermination de soi et de liberté.
Mais le dogme athée de ces courants modernes ne leur permet pas d’aller suffisamment loin dans le projet anthropologique. Par leur refus du Dieu de Jésus-Christ, ils refont de l’homme métaphysiquement libéré un «prisonnier de son sort mortel». Car l’homme libéré sans Dieu revient vivre à l’ombre de cet autre absolu qu’est devenu pour lui la mort, dont la raison ne sait que faire. C’est face à la mort que se joue et se détermine, en définitive, le destin de l’homme. Tant que l’homme n’accepte pas ce vide que crée en lui la mort, tant qu’il croit pouvoir le combler par ses propres créations, Dieu se tait. Il ne recommence qu’à interpeller l’homme si celui-ci parle de sa mort et se laisse interroger par elle. À bien voir, c’est la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui lui ouvre ce passage.
Refonder le christianisme, c’est donc revenir à la personne de Jésus-Christ, incarnation de Dieu dans l’histoire des hommes. Par lui, la révélation n’est pas une extériorité qui intervient avec force dans l’histoire. Au contraire, le concept de Dieu prend naissance de l’homme appelé à se libérer.
Le christianisme n’est pas nécessairement contraire à l’aspiration anthropologique moderne, ni celle-ci en opposition avec la foi chrétienne.
Pour penser son rapport à Dieu en termes d’autonomie, il faut que l’homme ait conquis ses premières libertés. La modernité a donc raison avec son projet anthropologique de détermination de soi. Plus encore, elle devient pour ainsi dire une condition de possibilité pour un christianisme qui ne veut pas retomber dans la problématique déiste pensant Dieu comme le tout absolu face à l’homme abîme d’impuissance et de misère.
D’autre part, l’athéisme que proclame la modernité compromet les chances de l’homme aspirant à sa véritable liberté. Écartant la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, le dogme athée refuse à l’homme de sortir de son sort mortel et le renferme à nouveau dans une structure aliénante semblable à celle du Dieu métaphysique que pourtant il voulait dépasser.
Par ses très fines analyses, qui font suite à ses autres travaux Transcendances. Essai sur Dieu et le corps (Desclée de Brouwer, 1989) et La détermination de soi. Anthropologie et religion (ibid. 1997), Yves Ledure, professeur à l’Université de Metz et spécialiste éminent de la philosophie moderne, montre bien que loin d’être une comète, étrangère à nos systèmes de valorisation, le christianisme rejoint l’homme dans son histoire et lui propose toujours à nouveau une aventure spirituelle originale.
Ce serait dommage si l’homme moderne ne le remarquait pas.
Jean-Jacques Flammang scj
Cette recension a été publiée dans “Die Warte”, Vue hebdomadaire sur les arts et les idées, du quotidien luxembourgeois “Luxemburger Wort”, jeudi 17 octobre 2002.
Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques
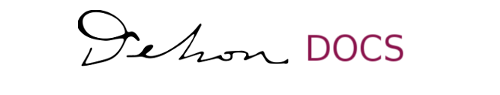

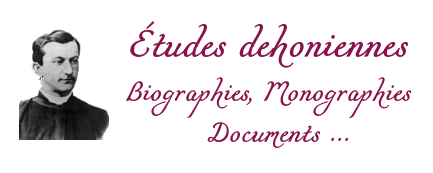


Recherche
Les derniers ajouts
Succès d'examen

Ces jours-ci, les Frères Pierre Tran et Antoine Do de la communauté dehonienne de Paris ont terminé avec succès leurs études de philosophie et de... Tout l'article
- Ascension du Seigneur
- Les forces de l'argent et du mal ne seront pas toujours vainqueurs...
- Vient de paraître - le Tome IV de la Correspondance de l'abbé Grégoire - Edition Jean Dubray
- In memoriam Père Paul Birsens SCJ
- Neues Buch von Michel Colince Kamdem SCJ
- In memoriam Fr. Pierre Rassarie scj
- Lettre du Général des Prêtres du Sacré-Coeur pour Pâques en période de pandémie
- Accompagnement pour la semaine sainte
- Accompagnement pour la semaine sainte


