Lettre du Supérieur Général pour la fête du Sacré-Cœur 2017

Rome, le 1er mai 2017
Donner à boire aux assoiffés,
donner à manger aux affamés
Lettre du Supérieur Général pour la Fête du Sacré-Cœur 2017
A tous les Prêtres du Sacré-Cœur
A tous les membres de la Famille dehonienne
UN SOUVENIR DE SOLFERINO
« C’est au milieu de ces combats si divers renouvelés partout et sans relâche qu’on entend sortir des imprécations de la bouche d’hommes de tant de nations différentes, dont beaucoup sont contraints d’être homicides à vingt ans ! […] Le commandant Mennessier dont les deux frères, l’un colonel et l’autre capitaine, ont déjà péri bravement à Magenta tombe à son tour à Solferino. Un sous-lieutenant de la ligne a le bras gauche brisé par un biscaïen et le sang coule abondamment de sa blessure ; assis sous un arbre il est mis en joue par un soldat hongrois, mais celui-ci est arrêté par un de ses officiers qui, s’approchant du jeune blessé français, lui serre la main avec compassion et ordonne de le porter dans un endroit moins dangereux.
« Des cantinières s’avancent comme de simples troupiers sous le feu de l’ennemi, elles vont relever de pauvres soldats mutilés qui demandent de l’eau avec instance, et elles-mêmes sont blessées en leur donnant à boire et en essayant de les soigner.
« A côté se débat, sous le poids de son cheval tué par un éclat d’obus, un officier de hussards affaibli par le sang qui sort de ses propres blessures ; et près de là, c’est un cheval échappé qui passe, entraînant dans sa course le cadavre ensanglanté de son cavalier ; plus loin des chevaux, plus humains que ceux qui les montent, évitent à chaque pas de fouler sous leurs pieds les victimes de cette bataille furieuse et passionnée. »
Près de la ville italienne de Solferino, Henry Dunant, l’auteur de ces lignes, durant un voyage en juin 1859, fut témoin des conditions épouvantables entre les blessés après une bataille entre l´armée autrichienne et les troupes de Sardaigne-Piémont et la France. Dunant, homme d’affaires suisse et humaniste d´inspiration chrétienne, a écrit à partir de son expérience un livre intitulé « Un souvenir de Solferino », qu’il a publié en 1862 à ses propres frais, en le distribuant en Europe. – Dunant avait compris qu´il n’y a rien de plus révolutionnaire que de décrire la réalité elle-même.
Aspirant à une société plus humaine, ce livre a connu un succès énorme. Déjà un an après la publication de l´original en français, l’auteur s’est rendu à Genève afin de fonder le « Comité International pour le secours aux blessés ». De cette organisation, quelques années plus tard, sont nés la Croix Rouge Internationale et le Croissant Rouge. Grâce à son œuvre Dunant, associé au pacifiste français Frédéric Passy, a reçu en 1901 le premier Prix Nobel de la Paix.
LE BON SAMARITAIN
La dynamique interne du récit du bon samaritain (Lc 10, 25-37) a marqué l’action de Dunant. Comme Jésus, Dunant était aussi convaincu que le salut vient des marginaux et que l´aide émane souvent de personnes auxquelles nous ne pensions pas. Comme Jésus, Dunant aimante aussi notre regard sur la réalité. L’histoire du bon samaritain se déroule dans un endroit réel : un tronçon de 27 kms environ, éprouvant et désolé, de la principale route commerciale d´alors entre l’Afrique et l’Asie : un tronçon situé en montagne, entre Jérusalem et Jéricho, dans la vallée de Jourdain.
Longeant la côte sur plus de mille mètres, cette route attirait beaucoup les commerçants et les voleurs. Réputée dangereuse, on l’appelait « route du sang » parce que c’était là que « le sang coulait souvent à cause des voleurs ». Mais elle restait très fréquentée. Un jour, un homme y tombe aux mains des voleurs. Cet homme, dont nous ne connaissons pas la nationalité, est agressé par les bandits, dépouillé et laissé là à moitié mort. Ni le lévite qui passe, ni le prêtre ne prennent soin du blessé.
C’est un Samaritain, un de ces étrangers, hérétique du point de vue religieux qui, mû de compassion, s’arrête. Jésus décrit de façon réaliste et détaillée les soins attentifs que le Samaritain apporte au blessé : le bandage des blessures, le brancard de fortune pour l’évacuation, l’hébergement, l’avance des frais médicaux, la promesse du retour. Il est intéressant de noter que pour le lévite et le prêtre, l’évangéliste recourt à deux verbes seulement : voir et passer, alors que pour l’action du Samaritain sont employés quatorze verbes. Le récit exemplaire du bon samaritain est utilisé par Jésus pour répondre à la question du docteur de la Loi : « Qui est mon prochain ? » (Lc 10, 29).
Chers frères, chers amis de notre Congrégation, comme vous le savez déjà, durant ces six années de notre mandat, nous voulons prendre en considération les œuvres de miséricorde, puisque le « Nom de Dieu est miséricorde » (Pape François). Ces œuvres de miséricorde, nous voulons non seulement les méditer, mais aussi les approfondir et les mettre concrètement en pratique. Dans les œuvres de miséricorde de nature spirituelle et corporelle nous reconnaissons l’expression directe de la dévotion au Sacré-Cœur. L’année dernière dans la Lettre pour la fête du Sacré-Cœur, nous avons mis l’accent sur le thème suivant : « accueillir les étrangers ».
Cette année nous voulons nous laisser interpeller par l’intensité de l´invitation à « donner à boire aux assoiffés et à manger aux affamés ». Notre Lettre du 14 mars, à l´occasion de l´anniversaire de la naissance de notre Fondateur le Père Dehon a déjà montré la direction. Avec celle-ci, nous voulons approfondir l´œuvre de miséricorde corporelle et nous demander sincèrement : Qui sont pour nous les assoiffés ? Où voyons-nous les affamés ?
AVOIR FAIM ET SOIF PHYSIQUEMENT, MENTALEMENT ET SPIRITUELLEMENT
Si nous ouvrons les yeux, nous voyons des personnes qui ont faim et soif au sens physique, intellectuel et spirituel. Nous voyons des personnes qui meurent de faim dans les champs de bataille clandestins que nos civilisations abritent : des jeunes qui grandissent sans nourriture suffisante, qui sont victimes des abus sexuels, mutilés ou chassés de leurs familles. D´autres personnes plus âgées se voient abandonnées, reléguées dans l’univers sombre des infirmités physiques. Dépourvues de soins médicaux, elles végètent dans une lente dérive vers la mort. D´autres encore sont frappées par des calamités naturelles et voient leurs maisons détruites et emportées on ne sait où. Dans de nombreux pays, des villages entiers courent constamment le risque de leur disparition, le taux de mortalité infantile demeure élevé. Beaucoup n’ont pas la possibilité d’échapper à la mort, tant manque l’eau potable, tant sont contaminées les sources d’approvisionnement. Tous ont soif d’eau, de vie, d’avenir.
intellectuel et spirituel. Nous voyons des personnes qui meurent de faim dans les champs de bataille clandestins que nos civilisations abritent : des jeunes qui grandissent sans nourriture suffisante, qui sont victimes des abus sexuels, mutilés ou chassés de leurs familles. D´autres personnes plus âgées se voient abandonnées, reléguées dans l’univers sombre des infirmités physiques. Dépourvues de soins médicaux, elles végètent dans une lente dérive vers la mort. D´autres encore sont frappées par des calamités naturelles et voient leurs maisons détruites et emportées on ne sait où. Dans de nombreux pays, des villages entiers courent constamment le risque de leur disparition, le taux de mortalité infantile demeure élevé. Beaucoup n’ont pas la possibilité d’échapper à la mort, tant manque l’eau potable, tant sont contaminées les sources d’approvisionnement. Tous ont soif d’eau, de vie, d’avenir.
Dans d´autres zones de guerre de nos civilisations, de nombreuses personnes prennent la fuite parce que la bataille fait rage. La guerre constitue pour elles une nouvelle injustice : mentalement elles vivent dans une inquiétude permanente, ne parvenant pas à trouver le moindre sommeil. C’est le règne de la peur : la peur des vengeances tribales, celle de Boko Haram, de l’EI, des kamikazes-suicides, des individus transformés en bombes humaines, des groupes radicaux foulant aux pieds les droits humains ou déversant facilement leur haine contre des groupes de confessions religieuses différentes. D’autres, en revanche, plus jeunes, se développent en santé et sécurité, mais ne savent pas prendre une décision. Ils ont faim d’orientation, faim d’un guide, indiquant la route, faim de conseil. Désorientés, ils tâtonnent comme des personnes qui, prisonnières de l’obscurité, se dirigent, hésitantes vers d’autres expériences.
A côté de ces champs de batailles géographiques et culturels, nous voyons d’autres personnes qui, intérieurement enchaînées, affrontent des zones de batailles psychologiques. Elles luttent contre une maladie ou sont elles-mêmes sérieusement préoccupées parce qu’elles vivent aux côtés d’une personne chère qui est malade. D’autres sont affligées par la perte d’un partenaire, s’abîment dans le chagrin ou tombent en dépression. Leur solitude les isole, personne ne remarque leurs larmes cachées. Elles ont faim de quelqu´un qui prenne le temps de les écouter. Elles ont soif d´espérance et de foi. Elles tendent vers Dieu et aspirent au Sauveur, à Celui dont l´amour ne se tarit pas, dont le cœur ne se fatigue jamais de soigner autrui.
En suivant les traces du Père Léon Dehon, nous possédons déjà la réponse apportée par nos collaboratrices et collaborateurs, amis et bienfaiteurs et par nous, dehoniens. Ensemble nous avons déjà décidé de chercher la proximité avec ceux qui ont faim, d’assister tous ceux qui ont soif. Certains parmi nous sont déjà en chemin, nous le savons, vers les affamés et les assoiffés, d’autres y travaillent plus discrètement, en silence. Pour la Fête de notre Dieu, qui a un Cœur ouvert sur le monde, et dont la miséricorde ne connaît pas de frontières, nous voudrions simplement vous dire: tout ce que vous vivez et accomplissez nous remplit de profonde gratitude. Votre solidarité avec les assoiffés et les affamés nous donne un élan nouveau et représente pour nous un motif de joie.
SEUL PAR « TOI » JE DEVIENS « MOI »
Comme Emmanuel Levinas, nous sommes convaincu que notre manière d’envisager l´autre, de le juger et de nous comporter avec lui, traduit quelque chose du regard que nous portons sur nous-mêmes, de la manière dont nous nous jugeons et dont nous nous comportons envers nous-mêmes. Je ne le connais pas mon dos. Seule la rencontre avec l’autre me permet de le voir et le connaître. Le bon Samaritain, s’affairant autour de l’homme laissé à moitié mort sur une route commerciale et internationale entre l’Afrique et l’Asie, opère un retour à l’intérieur de son âme et apprend à mieux se connaître lui-même.
C’est seulement par Toi que je deviens Moi, dit Martin Buber. L’histoire du bon Samaritain inverse à la fin le sujet et l’objet. Le Samaritain n’est plus sujet, et celui qu’il porte sur ses épaules n’est plus objet. Le récit montre plutôt comment le pauvre a compassion de moi, en m’aidant dans la situation d’épreuve intérieure ou extérieure que je traverse, et en m´assistant sur la route de mon accomplissement spirituel. Si, stimulés par le bon Samaritain, nous trouvons toujours plus notre identité spirituelle, nous devenons capables d’une attention plus grande. D’une conscience nouvelle. D’une perception réelle. Alors nous voyons ce qui est.
Nombreux sont les lieux qui révèlent notre identité spirituelle, et témoignent d’une authentique perception de la réalité. A Kisangani, au Centre Saint Gabriel, il existe un musée qui rappelle le sacrifice de la vie accompli par plus de quatre cents missionnaires. Ils sont arrivés de par le monde au cours du siècle dernier au Congo, pays qui a accueilli une des premières missions dehoniennes voulues par le Père Dehon.
Ce musée honore particulièrement nos martyrs qui ont été massacrés brutalement au cours des années soixante. Sur une paroi, on voit leurs photos, et devant on découvre un tableau représentant un beau crépuscule, accompagné d’une phrase emblématique de Mgr Emile Gabriel Grison, un des premiers missionnaires, premier évêque de Kisangani et fondateur du diocèse: « Il est difficile de planter la croix sur une terre de mission sans la porter. »
Une référence qui nous fait souvenir de tous les missionnaires martyrs qui ont donné leur vie pour l’évangélisation et qui nous rappelle nos missionnaires présents dans les diverses entités dehoniennes éparpillées à travers le monde. Nous savons que leur vie n’est pas facile, elle est perpétuellement sacrifice et donation et en même temps nous leur sommes reconnaissants du dévouement profond dont ils ont fait preuve, parce que sans cet esprit missionnaire, il ne peut y avoir de véritable évangélisation, ainsi que le souligne la phrase emblématique de Mgr Grison.
A travers l’attitude du bon Samaritain - qui est très souvent celle des missionnaires - Henri Dunant reconnaissait aussi ceci : je dois dire, ce qui est – et agir. On découvre, grâce à lui, que ce n’étaient pas uniquement des soldats qui soignaient des blessés sur le champ de bataille de Solferino, mais aussi des femmes qui accompagnaient le convoi militaire : les cantinières.
Ces femmes ont eu le courage d’intervenir, de se montrer solidaires. Elles donnaient à boire aux soldats mutilés, pansaient les plaies et souvent elles-mêmes étaient blessées. En outre, Dunant faisait référence aux chevaux. Ceux-ci paraissaient plus humains que leurs cavaliers. Comme s’ils étaient dotés d’un cœur plus grand, d’une compassion plus vive, lorsqu’avec leurs sabots ils cherchaient à éviter – plus que les cavaliers eux-mêmes – le contact avec les victimes.
Cette histoire réelle peut être aussi comprise comme une image du futur de notre Eglise. A plusieurs reprises, le Pape François comparait l’Eglise à un hôpital de campagne. Dans cet hôpital on doit réaliser la médecine d’urgence plutôt que de procéder à des enquêtes sophistiquées. Cet hôpital de campagne doit être monté « là où les combats ont lieu », dit le Pape François. L’Eglise doit sortir, aller au devant des personnes là où celles-ci « vivent, souffrent, espèrent ».
Laissons-nous toucher par le bon Samaritain, tournons notre attention vers les affamés et les assoiffés – comme Dehon, comme Dunant, et comme tant d’autres. En ce sens, nous souhaitons à tous la joie de nous confier à un Dieu dont le Cœur nous est ouvert. Au nom des membres de l’Administration générale, nous souhaitons à tous les confrères, aux collaboratrices et collaborateurs la multiplicité des dons de l’Esprit Saint pour la Fête du Sacré-Cœur !
In Corde Jesu
P. Heinrich Wilmer
Le Supérieur Général avec son Conseil
Découvrir notre nouveau site

Nos bibliothèques
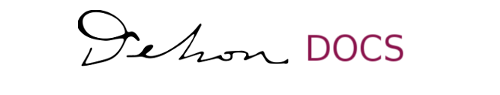

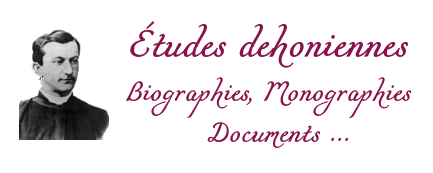


Recherche
Les derniers ajouts
Succès d'examen

Ces jours-ci, les Frères Pierre Tran et Antoine Do de la communauté dehonienne de Paris ont terminé avec succès leurs études de philosophie et de... Tout l'article
- Ascension du Seigneur
- Les forces de l'argent et du mal ne seront pas toujours vainqueurs...
- Vient de paraître - le Tome IV de la Correspondance de l'abbé Grégoire - Edition Jean Dubray
- In memoriam Père Paul Birsens SCJ
- Neues Buch von Michel Colince Kamdem SCJ
- In memoriam Fr. Pierre Rassarie scj
- Lettre du Général des Prêtres du Sacré-Coeur pour Pâques en période de pandémie
- Accompagnement pour la semaine sainte
- Accompagnement pour la semaine sainte


